L’été : entre soleil, moissons et merveilles
Un article pour les familles curieuses de transmettre les traditions de l’été : entre rites anciens, fêtes chrétiennes et contes français.

1. L’été, une saison de traditions et de merveilles
L’été n’est pas seulement synonyme de vacances et de beaux jours : c’est aussi une saison millénaire de célébrations et de merveilles. Dans les campagnes de nos ancêtres, l’arrivée des longues journées ensoleillées et des moissons était rythmée par des fêtes riches de sens. Des coutumes agricoles aux célébrations religieuses, de nombreux rites s’épanouissaient entre solstice d’été et récoltes, tissant un héritage culturel fascinant. Ce patrimoine, fait de lumière, de chaleur et de croyances partagées, est précieux à transmettre aux plus jeunes. Dans cet esprit chaleureux et pédagogique, partons à la découverte de ces traditions estivales – sans mièvrerie, mais avec cette touche poétique française qui fait rêver – pour mieux comprendre comment la nature en été peut devenir le plus bel enseignant de nos enfants.
2. Lugnasad : la fête celtique des moissons
Chez les Celtes de l’Antiquité, le cœur de l’été donnait lieu à l’une des plus grandes fêtes du calendrier : Lugnasad. Célébrée aux alentours du 1er août – à mi-chemin entre le solstice et l’équinoxe d’automne – elle marquait le début des récoltes estivales.
Son nom signifie « assemblée de Lug », en l’honneur du dieu Lug, grande divinité solaire et artisanale dans la mythologie celtique. Selon les récits irlandais, Lug lui-même aurait instauré cette fête en hommage à sa mère nourricière Tailtiu, une déesse de la Terre, dont le sacrifice garantissait l’abondance des récoltes.
Lugnasad prenait donc la forme d’un grand rassemblement communautaire : une foire où l’on célébrait la prospérité du royaume, où l’on redistribuait les récoltes, et où régnait une trêve sacrée propice à la paix et à l’amitié.
On y réglait les différends, nouait des mariages, écoutait poètes et musiciens, et organisait des jeux et concours athlétiques rappelant de petites Olympiades.
Toute la société celtique – druides, guerriers, artisans – se réunissait dans la convivialité pour célébrer la terre généreuse en cette période de moisson. Cette fête païenne de la moisson était si importante que son écho a perduré bien après la christianisation. Des historiens notent par exemple qu’en Gaule, les Romains avaient établi l’assemblée provinciale du Concilium Galliarum début août, possiblement en remplacement d’une célébration celtique à Lugus (Lug) sur le même emplacement.
En Bretagne médiévale, on retrouve la trace d’une fête appelée gouel eost (« fête d’août » en breton) et même d’un saint local, saint Luan (ou Luhan), célébré début août dont le nom semble dériver de Lugus.
Signe que la tradition de Lugnasad a pu se glisser sous le manteau chrétien. Lugnasad nous rappelle ainsi combien l’été était pour les anciens un temps de gratitude envers la nature et ses bienfaits, un moment d’unité où l’on remerciait la terre nourricière dans une atmosphère de fête. Pourquoi ne pas en parler à nos enfants en leur expliquant que nos lointains aïeux gaulois et celtes, bien avant l’électricité et les machines, observaient le rythme des saisons et fêtaient joyeusement la générosité de l’été ?
3. Du solstice aux feux de la Saint-Jean : rites païens et héritage chrétien
Au cœur de l’été se trouve un jour pas comme les autres : le solstice d’été, autour du 21 juin, jour le plus long de l’année dans l’hémisphère nord. Depuis la nuit des temps, ce moment où le soleil atteint son zénith a suscité des rites de célébration un peu partout en Europe. Dans l’Antiquité déjà, Celtes et Romains allumaient de grands feux de joie à la date du 24 juin pour honorer le soleil triomphant du solstice guipavas.bzh . Ces brasiers symbolisaient la lumière, la fertilité et la purification. On dansait autour des flammes, on sautait par-dessus le foyer pour se porter chance, convaincu que ce feu sacré protégeait les récoltes et éloignait les esprits malfaisants. De nombreuses croyances populaires y étaient liées : par exemple, en certaines régions de France, on pensait que les cendres de ces feux, répandues sur les champs, assureraient une moisson abondante l’année suivante guipavas.bzh . On profitait aussi de cette nuit magique pour cueillir des plantes médicinales – les fameuses herbes de la Saint-Jean – auxquelles on prêtait des vertus particulières lorsque le soleil était à son apogée lagazettecatalane.com . La fleur emblématique du solstice est d’ailleurs le millepertuis (le « chasse-diable »), traditionnellement récolté à cette occasion pour ses propriétés bienfaisantes lagazettecatalane.com . Toutes ces coutumes païennes célèbrent la vitalité de la nature au plus fort de l’été. Avec le christianisme, ces rites ancestraux ne disparurent pas : l’Église choisit de les intégrer en leur donnant une nouvelle signification. Dès le Ve siècle, elle a ainsi superposé la fête de la Saint-Jean-Baptiste (célébrant la naissance de Jean le Baptiste) au moment du solstice d’été guipavas.bzh . C’est l’origine des feux de la Saint-Jean, encore vivaces aujourd’hui. Chaque 24 juin, on allume des feux de joie – trois jours après le solstice – pour marquer cette fête chrétienne qui a hérité de tant de symboles païens. En France, la tradition est restée très populaire jusqu’au XX<sup>e</sup> siècle : dans nos villages, la nuit tombée, le plus âgé des habitants prénommés Jean avait l’honneur d’embraser le tas de bois dressé sur la place guipavas.bzh . Jeunes et vieux se rassemblaient autour du bûcher flamboyant pour chanter et partager un moment de convivialité, célébrant l’été dans la joie simple du feu qui crépite et éclaire la nuit guipavas.bzh . On raconte qu’en Bretagne, chacun apportait son fagot, les enfants couraient autour du feu en riant, et sur les hauteurs on voyait les feux des villages voisins briller à l’horizon – comme autant de fleurs de lumière semées dans le paysage estival guipavas.bzh . Ces feux de la Saint-Jean, bien qu’approuvés par l’Église, gardaient un parfum de magie champêtre : on y mêlait prières et superstitions locales. Par exemple, en Pays catalan, une légende affirme qu’un bouquet de la Saint-Jean cloué sur la porte protège la maison du Malin : on raconte qu’une jeune fille ayant cueilli à l’aube un ramellet (bouquet) de sept herbes sacrées put démasquer un prétendant qui était le diable déguisé – incapable d’entrer chez elle grâce aux vertus du bouquet, il s’enfuit en hurlant de dépit lagazettecatalane.com lagazettecatalane.com ! De telles histoires, transmises le soir au coin du feu, apportaient une touche de mystère et de frisson aux veillées d’été sans jamais effrayer outre mesure, et elles continuent de fasciner nos enfants lorsqu’on les leur raconte. Ainsi, du solstice païen à la Saint-Jean chrétienne, on voit une continuité : c’est toujours la puissance du soleil d’été, source de vie, qui est fêtée. Et aujourd’hui encore, allumer une petite flamme le 24 juin – ne serait-ce qu’une chandelle ou un feu de camp en famille – nous relie à cet héritage. On perpétue sans le savoir des gestes très anciens en sautillant par-dessus un feu de joie symbolique ou en cueillant quelques fleurs de la Saint-Jean au crépuscule. Transmis sans dogme ni idéologie, ces rites estivaux montrent aux enfants combien nos liens à la nature et aux saisons sont profonds : depuis des millénaires, l’être humain célèbre l’été comme un don du ciel, une apogée de lumière qui nourrit corps et âme lagazettecatalane.com . La Fête de la Saint-Jean (1875) par le peintre Jules Breton représente des villageois dansant autour d’un feu de joie estival, illustrant la tradition des feux de la Saint-Jean, héritière des célébrations du solstice d’été. lagazettecatalane.com guipavas.bzh
4. L’été, une école grandeur nature pour les enfants
En été, la nature elle-même devient un terrain d’apprentissage pour les plus jeunes. Il n’est pas étonnant que de nombreux pédagogues recommandent de profiter de cette saison pour l’éducation naturelle des enfants : la lumière intense, la douceur du climat, la richesse de la faune et de la flore offrent d’innombrables occasions de découvertes. Les longues journées ensoleillées permettent d’observer le lever et le coucher du soleil, de suivre le déplacement de l’ombre au fil des heures, de comprendre concrètement ce qu’est la rotation de la Terre – autant de petites leçons de science vécues les yeux levés vers le ciel. La chaleur de l’été, quant à elle, incite à passer du temps dehors, à courir pieds nus dans l’herbe, à sentir, toucher, expérimenter. Un enfant qui plante une graine au printemps et la voit donner fruit ou épi en été apprend la patience et le respect du vivant. Au potager ou au jardin, il découvre d’où viennent les tomates rouges qu’il déguste, il s’émerveille de voir les tournesols suivre la course du soleil. Loin des écrans et des salles de classe fermées, l’été offre une classe en plein air où chaque insecte pollinisateur, chaque orage d’août, chaque bain de rivière devient source d’émerveillement et de savoir. Les bienfaits de cette immersion estivale dans la nature sont immenses. Les chercheurs en sciences de l’éducation constatent que le contact direct avec la nature développe chez l’enfant non seulement son corps, mais aussi son intelligence, sa créativité et sa confiance en lui
. Courir dans les bois, grimper sur un rocher ou construire une cabane stimule la motricité et l’équilibre bien mieux que n’importe quelle salle de jeux en intérieur
. Observer les fourmis à l’ouvrage ou les étoiles dans le ciel étoilé nourrit la curiosité scientifique. Et puis, l’été apprend aussi l’autonomie : c’est souvent la période où, selon leur âge, les enfants osent un peu plus de liberté – ils font du vélo dans le quartier, aident papy au jardin, partent en petit camp nature ou simplement jouent dehors des journées entières avec les copains. Sous le regard bienveillant des parents, cette autonomie estivale est formatrice. On a même remarqué que passer du temps dehors améliore la santé des enfants : davantage de lumière du jour pour les yeux (ce qui réduit le risque de myopie), plus d’activité physique pour un corps en forme, moins de stress et un meilleur sommeil le soir venu
. Comme le résume joliment un spécialiste, « dans la nature, l’enfant peut développer l’ensemble de sa personne : son corps, son intelligence, ses relations avec les autres et sa personnalité »
. En somme, la saison estivale est une alliée précieuse des parents et des éducateurs : elle met à disposition un grand livre d’images vivant – champs dorés, forêts verdoyantes, rivières scintillantes – dans lequel nos petits apprennent avec joie, sans même s’en apercevoir. Profitons-en pour les accompagner dans ces découvertes, répondre à leurs questions sur la course du soleil, le cycle de l’eau ou le chant des cigales… L’été éduque le cœur autant que l’esprit, en forgeant des souvenirs heureux qui resteront gravés.
5. Contes et fables au parfum d’été à raconter
Les contes et fables transmis de génération en génération sont un merveilleux moyen d’évoquer l’été et ses enseignements auprès des enfants. La littérature française regorge d’histoires champêtres et ensoleillées que l’on peut lire ou raconter lors des longues soirées d’été. Parmi les plus célèbres figure la fable du Laboureur et ses enfants de Jean de La Fontaine (1668). Cette courte fable met en scène un vieux paysan viticulteur qui, sentant sa fin proche, réunit ses deux fils et leur confie qu’un trésor est caché dans leur vigne. À sa mort, les enfants, pleins de zèle, se mettent à creuser la terre de long en large pour trouver le trésor enfoui. Ils ne découvrent aucune caisse d’or… mais, à la fin de l’année, la vigne ainsi retournée donne une récolte exceptionnellement abondante. Le « trésor » était en réalité le travail assidu qu’ils ont fourni : « Le père fut sage / De leur montrer avant sa mort / Que le travail est un trésor » conclut La Fontaine
. La morale, exprimée dans un langage du XVIIe siècle, reste d’une grande modernité : c’est en se retroussant les manches et en prenant soin de la terre que l’on obtient les plus belles récompenses. Voilà un message que les parents peuvent expliquer aux enfants, en lien direct avec l’été des moissons : comme ces deux frères de la fable, les petits peuvent comprendre que planter, arroser, désherber – bref, participer aux tâches du jardin ou du potager familial – porte ses fruits. On peut même mimer la fable avec eux, en enfouissant par jeu un petit « trésor » (par exemple des bonbons ou un petit jouet) dans le bac à sable ou le carré de terre à cultiver, qu’ils ne trouveront qu’après avoir bien fouillé et bêché ! Les contes populaires régionaux, eux aussi, célèbrent à leur manière les merveilles de l’été. Dans le Midi de la France, on raconte par exemple la légende du Bouquet de la Saint-Jean : il était une fois une jolie bergère catalane nommée Maria qui, le soir de la Saint-Jean, rencontra un charmant étranger. Méfiante devant ce bel inconnu apparu comme par enchantement, elle alla à l’aube cueillir en secret sept plantes sauvages qu’elle lia en bouquet et fixa en croix sur sa porte. Lorsque le mystérieux jeune homme se présenta chez elle, impossible pour lui d’entrer : pris de malaises, il recula et finit par disparaître en laissant une odeur de soufre… C’était le diable en personne, et le bouquet de Saint-Jean aux herbes sacrées venait de sauver la bergère de ses griffes.
Ce conte plein de malice, transmis dans tout le Roussillon, permet d’évoquer avec les enfants la puissance protectrice des plantes et la magie du solstice d’été – sans pour autant verser dans la peur, car la morale est positive : la nature bien utilisée (ici le bouquet d’herbes) triomphe du mal. On peut théâtraliser cette histoire à la veillée, autour d’un petit feu ou même de quelques bougies, en faisant jouer les rôles (la bergère, le galant-diable, etc.) aux enfants pour leur plus grand plaisir. Il existe bien d’autres contes liés à l’été à piocher dans notre patrimoine : citons par exemple La Pastourelle, une ancienne chanson-contée occitane où une bergère fûtée joue de malice avec un seigneur trop entreprenant – manière amusante de montrer l’importance de la ruse et de l’autonomie, même chez les plus humbles, sous le soleil des estives. Ou encore la célèbre fable La Cigale et la Fourmi, qui se déroule en plein été : la cigale chante tout juillet sans se soucier de ses provisions, alors que la fourmi s’active pour l’hiver… Une histoire bien connue qui peut ouvrir la discussion (faut-il être prévoyant comme la fourmi ou profiter de l’instant présent comme la cigale ?). L’essentiel est de choisir des récits adaptés à l’âge de vos enfants (3 à 10 ans dans notre cas) et de les raconter avec chaleur. Ces contes aux parfums de foin coupé, de lavande ou de blé mûr captivent l’imaginaire et transmettent en douceur les valeurs de notre héritage estival : l’amour du travail bien fait, le respect de la nature, la ruse face à l’adversité, la joie de vivre ensemble les beaux moments de l’été.
Sources
F. Le Roux & C.-J. Guyonvarc’h, Les Fêtes celtiques (Ouest-France, 1995) – Encyclopédie Universalis, article « Solstice d’été » – M. Boucher, « Les feux de la Saint-Jean », Bulletin AGIP Guipavas n°20 (2012) guipavas.bzh guipavas.bzh – J. de La Fontaine, Fables, 1668 (Livre V, fable 9) fr.wikipedia.org – J.-L. Modat, « Herbes de Saint Jean » (La Gazette Catalane, 23/06/2020) lagazettecatalane.com lagazettecatalane.com – M. Astier, « Les enfants grandissent mieux dans la nature » (Reporterre, 2023) reporterre.net – Office de Tourisme Vaucluse, « Légende des 7 épis de blé » (2021) j-aime-le-vaucluse.com .
Vous pourriez aimer aussi :

La Chandeleur : fête de la lumière et des crêpes
Cet article propose aux parents d’expliquer simplement la Chandeleur aux enfants et d’où vient cette fête.
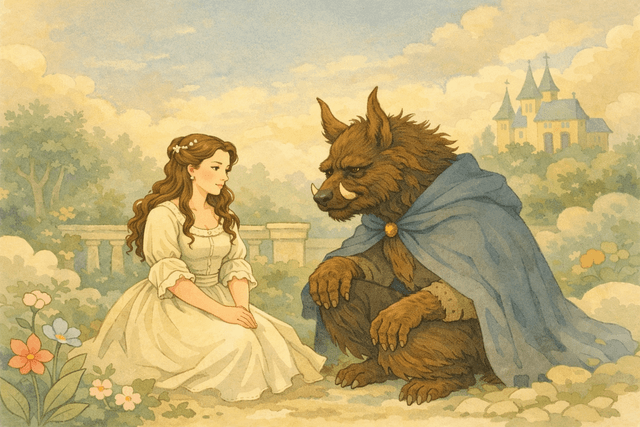
La Belle et la Bête (1756) — Version de Beaumont (Magasin des enfants)
La version longue (1740) de La Belle et la Bête par Madame de Villeneuve, orthographe modernisée, idéale en lecture acco…

La galette des rois : histoire, traditions et gourmandise
Découvre l’histoire de la galette des rois, ses origines anciennes, ses coutumes familiales et les deux grandes recettes…

Noël : histoire, traditions et lumière d’hiver
Découvre les origines du sapin, de la crèche, des chants, et la naissance de Jésus : un voyage à travers les traditions …


Et toi, qu’en as-tu pensé ?