Le chardonneret : l’oiseau aux couleurs d’espérance
"Dans les vergers et les haies, un petit oiseau au masque rouge et aux ailes d’or apparaît par instants dans un éclat de couleurs."
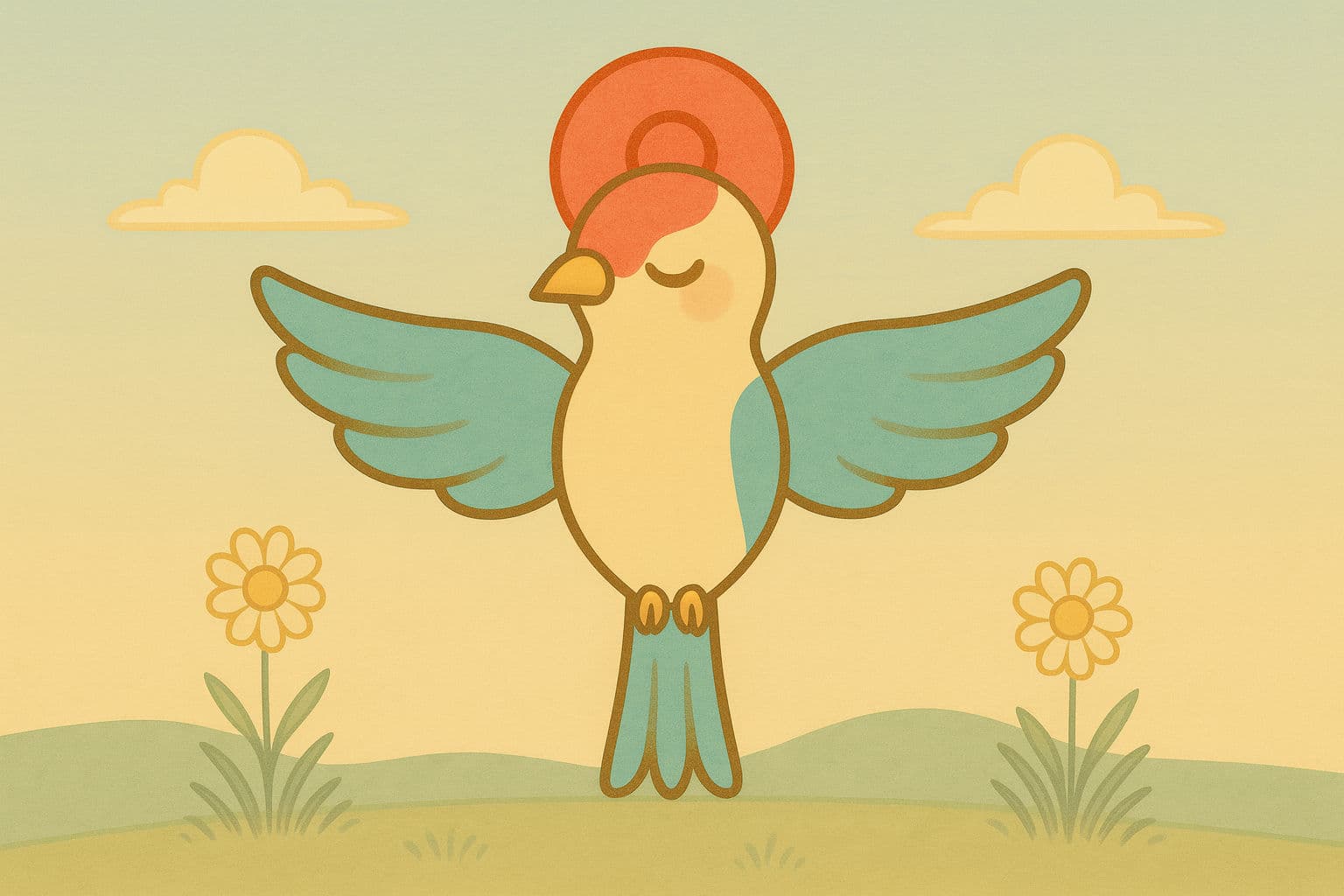
1. Un petit oiseau qui aime les chardons
Le chardonneret se nourrit surtout de graines de chardons, des plantes remplies de petites épines.
Il est très facile à reconnaître :
- une tache rouge sur la tête,
- des ailes jaunes et noires,
- un chant vif et joyeux.
Au Moyen Âge, les chrétiens disaient que cet oiseau « vit parmi les épines ».
Cela leur faisait penser à la couronne d’épines de Jésus.
2. Le chardonneret dans l’art chrétien
Dans les sculptures et peintures du Moyen Âge et de la Renaissance, on voit souvent :
- l’Enfant Jésus tenant un chardonneret,
- Marie regardant l’oiseau,
- des œuvres appelées “Vierge au chardonneret”.
Pourquoi ce choix ?
Parce que cet oiseau annonce la Passion de Jésus :
- les chardons → les épines,
- le rouge → le sang versé,
- les ailes dorées → la lumière de la Résurrection.
Les artistes utilisaient un petit oiseau familier pour transmettre un message profond, mais compréhensible.
3. La légende de l’oiseau compatissant
Depuis longtemps, une belle légende est racontée aux enfants :
Un chardonneret aurait essayé d’enlever une épine de la couronne de Jésus.
Une goutte de sang serait tombée sur sa tête.
C’est ainsi que le chardonneret aurait reçu sa tache rouge.
Ce n’est pas un fait historique, mais une histoire de compassion, pour montrer que même un petit être peut vouloir aider.
4. Que symbolise le chardonneret ?
Pour les chrétiens, le chardonneret rappelle :
- les épines → la souffrance,
- le rouge → le courage et l’amour,
- son chant → la vie qui renaît.
Pour les enfants, il devient :
- un oiseau facile à reconnaître,
- un symbole d’espérance,
- un moyen doux de parler de la Passion.
Références
Saint Isidore de Séville, Étymologies (VIIᵉ siècle)
- Sculptures médiévales : “Vierge au chardonneret”
- Charbonneau-Lassay, Le Bestiaire du Christ (légende du chardonneret)
Vous pourriez aimer aussi :

La Chandeleur : fête de la lumière et des crêpes
Cet article propose aux parents d’expliquer simplement la Chandeleur aux enfants et d’où vient cette fête.
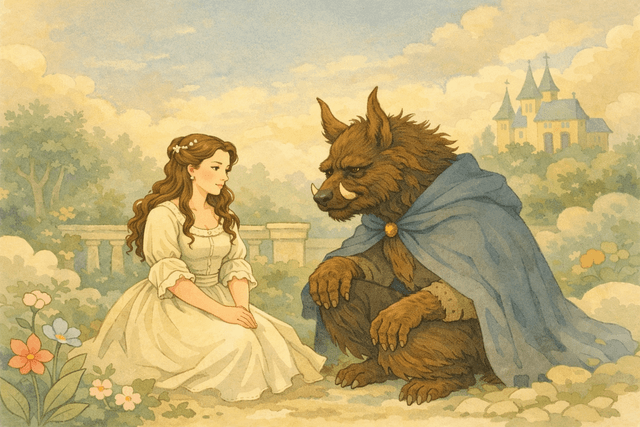
La Belle et la Bête (1756) — Version de Beaumont (Magasin des enfants)
La version longue (1740) de La Belle et la Bête par Madame de Villeneuve, orthographe modernisée, idéale en lecture acco…

La galette des rois : histoire, traditions et gourmandise
Découvre l’histoire de la galette des rois, ses origines anciennes, ses coutumes familiales et les deux grandes recettes…

L’Avent : un chemin de lumière vers Noël
Un voyage à travers l’histoire de l’Avent : ses origines anciennes, sa signification, la couronne, le calendrier et les …
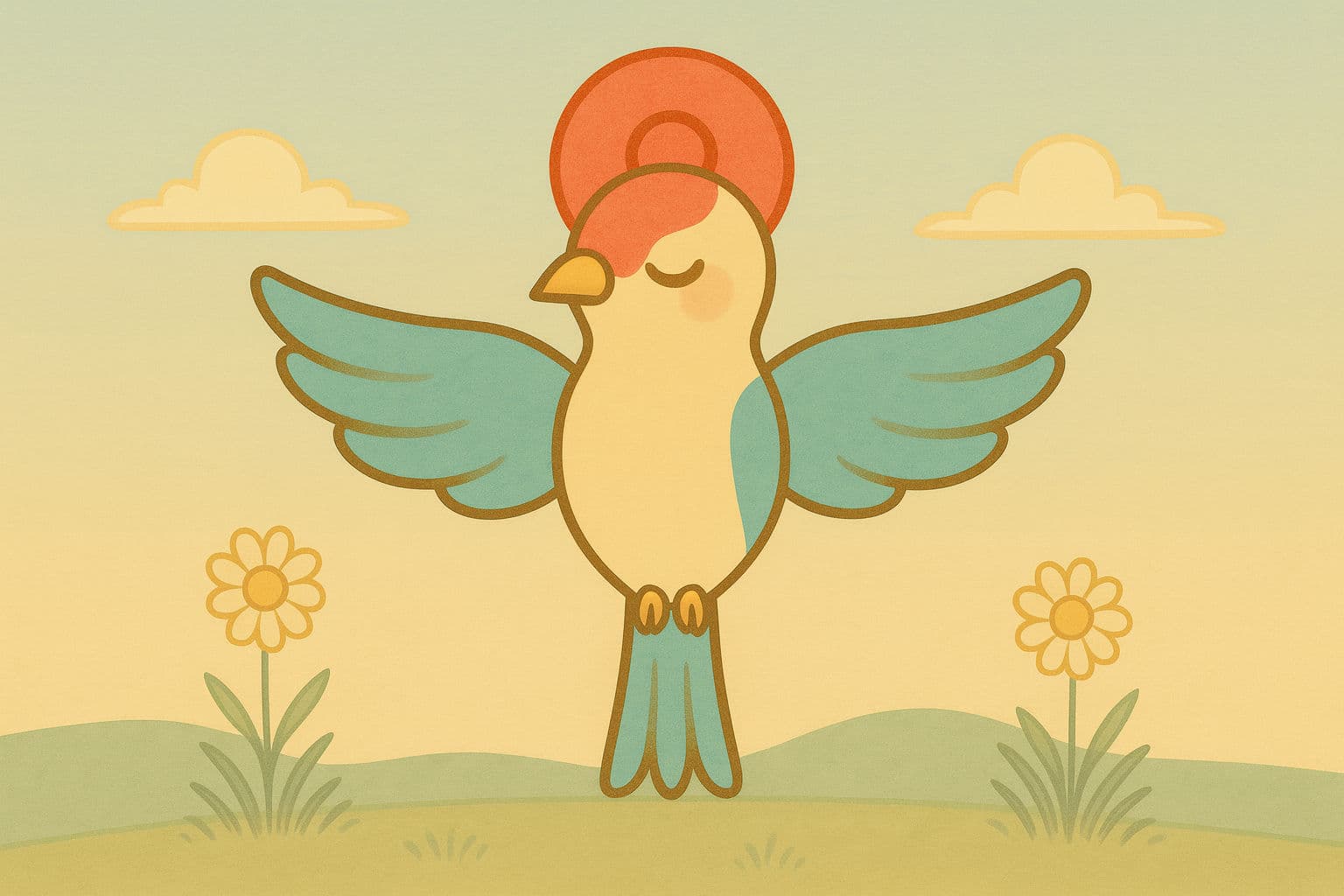

Et toi, qu’en as-tu pensé ?