L’hiver : silence, lumière et renaissances cachées
L’hiver est traditionnellement le temps du silence et du repos.
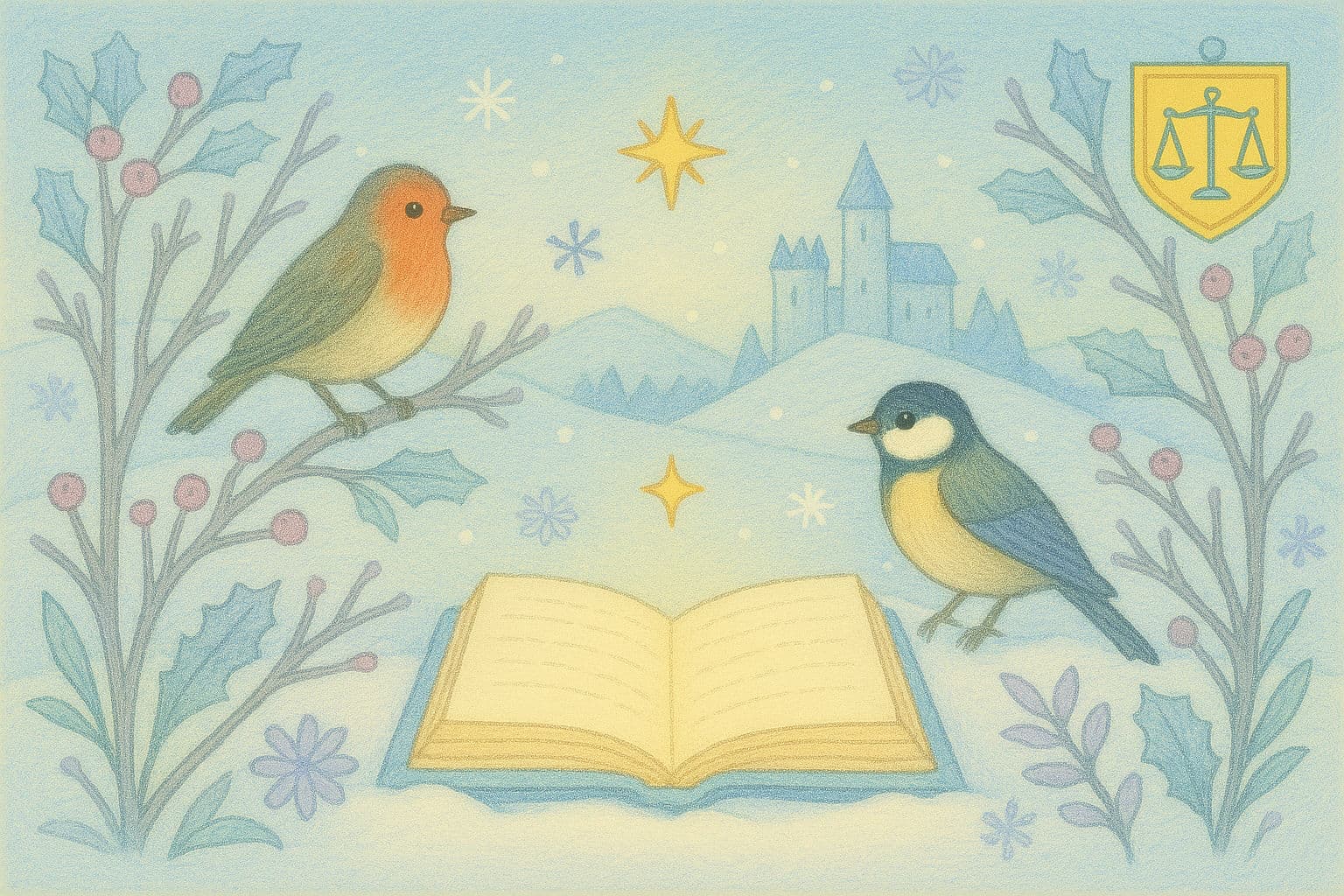
1. Aux origines de la lumière hivernale : solstice et feux de joie
Le solstice d’hiver, aux alentours du 21 décembre, marque le jour le plus court de l’année. Dans l’Antiquité européenne, c’était un moment rempli d’espoir : après le solstice, les jours rallongent.
De nombreuses fêtes anciennes s’y rattachent. À Rome, on célébrait les Saturnales : grandes réjouissances où l’on abolissait symboliquement les hiérarchies sociales. Maîtres et esclaves banquetaient ensemble, en souvenir de l’Âge d’Or ; il n’y avait ni tribunaux ni querelles¹. Lors de ces festins, un simple haricot (fève) caché dans un gâteau désignait un “roi” éphémère choisi au hasard, souvent un serviteur couronné pour rire². Cette coutume de la fève, qui donne le pouvoir au plus humble pendant une journée, a traversé les âges : on la retrouve dans la galette des rois de janvier.
C’est là un bel exemple de transmission discrète d’un rite païen par la fête chrétienne de l’Épiphanie (commémoration des Rois mages).
Face à ces célébrations populaires du soleil invaincu au cœur de l’hiver, la jeune Église chrétienne choisit de placer la Nativité de Jésus au 25 décembre (dès le IVᵉ siècle), en correspondance symbolique avec le renouveau solaire du solstice³. On présentait ainsi le Christ comme « la lumière du monde », née au moment où le soleil recommence sa course ascendante.
De même, la fête de Sainte Lucie (le 13 décembre) doit son nom au latin lux (lumière) et tombait autrefois le jour du solstice dans l’ancien calendrier julien. Un dicton ancien affirme qu’à la Sainte-Luce, « les jours croissent du saut d’une puce »⁴ : dès la mi-décembre, la clarté du jour gagne symboliquement un minuscule instant de plus, signe encourageant que la nuit ne sera pas éternelle.
Pour traverser le cap du solstice, les traditions européennes ont multiplié les rites de lumière et de feu. Allumer une flamme au cœur de l’obscurité, c’est affirmer la continuité de la vie.
Dans de nombreuses régions de France, la nuit de Noël donne lieu à la coutume de la bûche de Noël : un gros tronc de bois, choisi et séché à l’avance, que l’on fait brûler dans l’âtre le soir du 24 décembre. Ce feu doit durer longtemps, parfois jusqu’au Nouvel An, et ses braises sont précieusement conservées. La première mention écrite de la bûche de Noël remonte au XIIIᵉ siècle, et l’on sait qu’au Moyen Âge chaque foyer entretenait ce feu familial lors des veillées de fin d’année⁵.
En Provence, on appelait ce rituel le cacho-fio : la bûche était portée cérémonieusement jusque dans la cheminée, bénie avec du vin par le plus jeune enfant, puis allumée avec solennité⁶. On en rallumait un tison chaque soir jusqu’à l’Épiphanie ; l’on gardait un morceau de charbon ou de cendre, auquel on attribuait des vertus protectrices : contre la foudre, pour assurer de bonnes récoltes ou aider les animaux⁶.
Au cœur de l’hiver, le foyer restait incandescent, symbole de chaleur vitale et de communion entre générations.
Outre le feu, on célèbre aussi la verdure persistante. Quand tout semble mort, les conifères gardent leurs aiguilles vertes : ainsi naît la tradition de l’arbre de Noël décoré.
La première trace historique d’un arbre coupé pour Noël vient d’Alsace en 1521 : des forestiers furent payés pour couper des sapins destinés à orner la ville de Sélestat⁷. Mais bien avant le sapin décoré de bougies et de rubans, on avait pour habitude, dès l’Antiquité tardive, de disposer quelques rameaux verts et des lampes à huile dans les maisons au cœur de l’hiver – coutume populaire dénoncée par Tertullien au IIIᵉ siècle, preuve qu’elle était vivace chez les premiers chrétiens⁷.
L’hiver est ainsi paré d’une lumière cachée : celle des flammes dans la nuit et celle de la verdure tenace, qui toutes deux promettent le retour du printemps.
Notes
- Cf. Macrobe, Saturnales, I, 7.
- Cf. J. Bédier, La Fête des Rois, 1914.
- Cf. Liber Pontificalis, IVᵉ s.
- Proverbe traditionnel (Provence, Berry).
- Chronique de Pierre de Langtoft, XIIIᵉ s.
- J.-B. Fabre, Noëls provençaux, 1835.
- Archives de Sélestat, 1521 ; Tertullien, De Idololatria, c. XV.
2. Veillées d’hiver : contes, pain partagé et lanterne au coin du feu
Loin des grands mythes et des rites officiels, la vie quotidienne en hiver s’organisait autrefois autour des longues veillées au coin du feu. Les travaux des champs cessant presque complètement, familles et voisins d’un hameau se retrouvaient le soir dans une grange ou autour de l’âtre d’une cuisine.
« Il est de coutume d’attribuer la tradition orale des contes populaires aux longues veillées d’hiver qui réunissaient tour à tour, dans l’une ou l’autre maison, tous les voisins d’un même village », rappelle un historien⁸.
C’est surtout lors de ces soirées que les conteurs transmettaient aux plus jeunes les histoires locales, les légendes régionales et les récits merveilleux du patrimoine.
Dans toutes les provinces de France, jusqu’au XXᵉ siècle, ces veillées ont perduré comme moments de sociabilité incontournables dès l’automne et tout l’hiver⁸.
On filait la laine, on égrenait le maïs, on réparait les outils, tout en racontant des histoires.
C’était un temps d’initiation douce pour les enfants : ils écoutaient les aînés et apprenaient les coutumes de la communauté.
La veillée était aussi synonyme de partage concret.
Dans les campagnes, on profitait de l’hiver pour cuire le pain familial au four communal. À Noël, cette cuisson prenait un sens particulier : on confectionnait le pain de Calende, une grosse miche blanche spéciale cuite le 24 décembre⁹.
Ce pain ritualisé était partagé plus tard, le jour des Rois (6 janvier), en autant de parts qu’il y avait de convives, plus une part supplémentaire “pour les pauvres” ou pour l’invité imprévu.
Ce morceau consacré à l’hospitalité rappelait que la période de Noël est aussi celle de la charité et du don.
Parfois, on réservait un petit bout de ce pain béni pour des usages médicinaux : selon la croyance, il pouvait servir de remède contre certains maux ou protéger la maison toute l’année⁹.
De même, après la Messe de minuit, il était coutume dans plusieurs régions de partager une soupe chaude ou un bouillon en famille, symbole de frugalité (on avait jeûné pendant l’Avent) et de réconfort fraternel au cœur de la nuit.
Pendant ces veillées, on fabriquait aussi de petits objets de lumière pour agrémenter l’obscurité.
En Alsace et en Allemagne, les enfants confectionnaient dès décembre des lanternes de papier ou creusaient des betteraves pour en faire des lampions : ils les utilisaient lors des défilés de la Saint-Martin (11 novembre) ou pendant l’Avent.
En France, l’usage de lanternes artisanales à Noël est moins attesté, mais on illuminait volontiers la maison de chandelles pour la veillée : chaque bougie allumée représentait une prière ou un souhait.
En Bretagne, on plaçait une chandelle bénie à la fenêtre pour guider symboliquement la Sainte Famille dans la nuit de Noël.
Dans de nombreuses églises de campagne, la nuit du 24 décembre, les fidèles apportaient chacun une chandelle ou une lampe : toutes réunies, elles éclairaient l’office de minuit, spectacle inoubliable pour les enfants émerveillés par la profusion de flammes vacillantes dans la nef obscure.
Enfin, l’hiver était la saison propice pour observer la nature et en tirer des proverbes météorologiques.
Les Anciens scrutaient le comportement des animaux, la forme des nuages, la date des premières neiges, et en déduisaient des présages pour l’année à venir.
Par exemple, on disait que les douze jours entre Noël et l’Épiphanie annonçaient le temps des douze mois de l’année : tel jour de fin décembre correspondait à tel mois à venir ; si ce jour était clair, le mois serait sec, etc.
Ce genre de croyance, répandue dans toute l’Europe, rendait l’enfant attentif aux moindres variations de la nature pendant la morte-saison.
La neige elle-même nourrissait l’imaginaire.
Chaque région avait sa poésie pour expliquer la neige aux enfants : laine de Dame Holle dans les contes de l’Est, plumes d’oie, confettis du paradis, danse des esprits de l’hiver.
Ainsi, loin d’être un temps d’ennui ou d’angoisse, l’hiver devenait un terrain de jeu de l’esprit et un moment de transmission ludique du savoir populaire.
Notes
- G. Dumézil, Veillées et traditions populaires, 1941.
- E. Rolland, Coutumes et croyances du Berry, 1877 ; J.-L. Beaucarnot, Le Pain de Calende, 2003.
La légende de Dame Holle, l’esprit de l’hiver
Dans les contes européens, l’hiver est souvent personnifié par une vieille femme mystérieuse, tantôt bienveillante, tantôt sévère, qui contrôle les neiges et les frimas.
L’un des plus célèbres récits à ce sujet est la légende de Dame Holle (ou Frau Holle), collectée par les frères Grimm au début du XIXᵉ siècle. En voici une version résumée :
Il était une fois une veuve qui avait deux filles : l’une était active, gentille et belle ; l’autre, paresseuse, capricieuse et laide de cœur. La mère, hélas, préférait nettement la fille paresseuse, car c’était sa propre enfant, et accablait l’autre de toutes les corvées.
Chaque jour dès l’aube, la pauvre jeune fille devait filer la laine au bord d’un puits, jusqu’à en avoir les doigts en sang.
Un matin, en se penchant pour rincer sa quenouille tachée de rouge, l’outil lui glissa des mains et tomba au fond du puits. Désespérée, l’orpheline alla raconter sa mésaventure à sa marâtre, qui la gronda durement :
« Tu as laissé tomber la quenouille ? Eh bien, descends la chercher ! »
La brave enfant retourna près du puits sans savoir que faire, et, dans son angoisse, sauta dans l’eau pour tenter de récupérer son fuseau…
Lorsqu’elle reprit conscience, la jeune fille se retrouva dans une prairie merveilleuse, sous un soleil éclatant.
En suivant un petit chemin, elle arriva près d’un four à pain débordant de miches dorées.
« Retire-nous ! Retire-nous, nous allons brûler ! », criaient les pains.
Sans hésiter, elle saisit la pelle et sortit tous les pains du four, puis reprit sa route.
Plus loin, elle passa sous un pommier croulant sous les fruits.
« Secoue-moi, je t’en prie ! Mes pommes sont mûres et alourdissent mes branches… », supplia l’arbre.
La jeune fille secoua vigoureusement le pommier, qui la gratifia d’une pluie de pommes mûres qu’elle rassembla en un tas soigné.
Finalement, elle parvint devant une petite maison d’où l’observait une vieille femme au nez pointu et aux dents longues.
Effrayée, la fillette voulut s’enfuir, mais la vieille la héla d’une voix douce :
« N’aie pas peur, mon enfant… Reste donc chez moi. Si tu fais soigneusement les travaux de la maison, tu seras bien traitée. Tu auras ici du bon temps, du pain frais et du rôti chaque jour. Seulement, il faut prendre garde à bien secouer mon édredon chaque matin, jusqu’à ce que les plumes s’envolent – alors il neige sur le monde, car c’est moi qui suis Dame Holle ! »¹⁰
À ces mots, la jeune fille comprit qu’elle était chez la maîtresse de l’hiver en personne.
Elle accepta de servir Dame Holle, et s’appliqua chaque jour à faire le ménage, la cuisine, et surtout à secouer vigoureusement le grand édredon de plumes. Jamais la neige ne manqua de tomber sur la Terre à l’heure où elle secouait la couette !
En échange de son zèle, la fillette menait une vie agréable dans la maisonnette enchantée, où nulle parole méchante n’était jamais prononcée à son égard.
Au bout de quelque temps, pourtant, la mélancolie la gagna : malgré tout le confort, elle eut le mal du pays et voulut revoir sa famille.
Dame Holle lui dit alors :
« Tu m’as servi fidèlement, je vais te ramener chez toi. »
Elle lui prit la main et la conduisit sous une grande porte.
Quand la jeune fille passa le seuil, une pluie d’or se déversa sur elle et la couvrit de la tête aux pieds.
« C’est ta récompense pour ton bon travail », dit la vieille. Elle lui rendit aussi la quenouille perdue, et la renvoya dans le monde des humains.
De retour à la maison, la jeune fille – resplendissante sous son manteau d’or – fut accueillie avec stupéfaction par sa mère et sa demi-sœur.
Celles-ci, jalouses de sa fortune, voulurent obtenir le même trésor. La sœur paresseuse s’en alla donc à son tour au puits, exprès, et sauta dedans pour arriver au royaume de Dame Holle.
Elle fit semblant de suivre le même chemin ; mais trop indolente pour aider le pain ou cueillir les pommes, elle laissa four et pommier en plan.
Arrivée chez Dame Holle, la fille se montra d’abord obéissante dans l’espoir d’être couverte d’or, puis très vite retomba dans sa paresse : elle se levait tard, bâclait les tâches, et oublia de secouer le grand édredon…
Au bout de quelques jours, Dame Holle la renvoya.
La vieille la fit passer sous la porte magique, mais au lieu de l’or espéré, c’est un chaudron de poix noire (goudron) qui se déversa sur la vilaine fille et la recouvrit entièrement.
« Voilà le salaire de tes services », déclara Dame Holle en refermant le portail.
C’est donc une fille couverte de poix – et cette poix, dit-on, ne se détacha jamais de son corps – qui rentra au foyer.
Le coq du voisin, en l’apercevant, chanta ces mots moqueurs :
« Cocorico ! Voilà notre fille malpropre qui rentre au bercail ! »
Fin de l’histoire, et fin de la leçon…
Origine et portée de la légende
La légende de Dame Holle est un conte populaire du centre de l’Europe, dont la version la plus connue a été publiée par Jacob et Wilhelm Grimm en 1812.
Les Grimm tenaient ce récit de la tradition orale de Hesse (Allemagne) : dans cette région, on disait aux enfants que lorsque la neige tombe, c’est « Dame Holle qui secoue son lit »¹¹.
Dame Holle est l’incarnation féminine de l’hiver, maîtresse du froid mais aussi gardienne des forces de renaissance (elle récompense le travail qui prépare le printemps).
Sous des dehors de fée-grand-mère redoutable, elle enseigne la valeur du courage, de la bonté et du travail bien fait.
Ce conte très ancien rappelle que l’hiver n’est pas qu’une saison morte : c’est le temps où se tissent en secret les récompenses futures.
Notes
- Grimm, Kinder- und Hausmärchen, n°24, 1812.
- Proverbe de Hesse, cité par les Grimm dans l’introduction à Frau Holle.
Sources
-
Horace, Satire II, 7 (env. 35 av. J.-C.), évoque les « libertés de décembre » durant les Saturnales, où les esclaves festoyaient à la table de leurs maîtres. Voir Nadine Cretin, « Le solstice d’hiver et les traditions de Noël », Questes, vol. 34, 2016, p. 139-146, qui décrit les Saturnales comme une période de trêve sociale propice au partage fraternel (banquets égalitaires, inversion des rôles, mascarades, etc.), d’où l’influence de ces rites antiques sur nos fêtes hivernales modernes.
-
Margot Hinry, « Épiphanie : d’où vient la tradition de la galette des rois ? », National Geographic, 5 janvier 2022. – Lors des Saturnales romaines, un roi bouffon était tiré au sort (souvent via une fève dissimulée dans un gâteau) parmi les esclaves, lesquels pouvaient commander symboliquement pendant la fête. Cette coutume de la fève porteuse de royauté s’est perpétuée au Moyen Âge et à l’époque moderne dans la célébration de l’Épiphanie (galette des rois).
-
Nadine Cretin, art. cit. (Questes, 2016), p. 148-150. – En 274, l’empereur Aurélien officialise le culte du Sol Invictus (« Soleil invaincu ») célébré le 25 décembre (date où le soleil recommence à grandir). Au IVᵉ siècle, l’Église chrétienne institue la fête de Noël à cette même date pour signifier que le Christ, “lumière du monde”, succède aux divinités païennes solaires. Saint Augustin, dans ses Sermons, exhortait ainsi : « Ne célébrez pas ce jour à la manière des païens pour le soleil, mais pour celui qui a créé le soleil » (Sermon 190).
-
« À la Sainte-Luce, le jour croît du saut d’une puce ». – Proverbe français ancien, à l’époque où le calendrier julien était en vigueur (avant 1582), le 13 décembre correspondait au solstice d’hiver. Le choix du 13 décembre pour fêter sainte Lucie de Syracuse procède d’ailleurs de l’étymologie de son nom (lux, la lumière) : c’est le dies luci où la lumière du jour recommence à croître imperceptiblement. Cf. Dictionnaire de la France pittoresque, éd. La France pittoresque, 2016, art. « Sainte-Luce » : « avant la réforme, les jours recommençaient à augmenter le 13 décembre, d’où le dicton, aujourd’hui fautif mais jadis vrai, “heureux jour de Sainte-Luce” ».
-
Roger Vaultier, Le Folklore pendant la Guerre de Cent Ans d’après les lettres de rémission du Trésor des Chartes, Paris, 1945, p. 83-86. – De nombreux documents médiévaux et modernes attestent la coutume de la bûche de Noël dans toute la France : par exemple, une lettre de rémission de 1395 (Montfaucon, Normandie) mentionne explicitement la « souche » de Noël, et certains droits seigneuriaux du XIIIᵉ siècle obligeaient déjà les paysans à fournir une bûche au château pour Noël. L’usage, très ancien, est universellement attesté en Europe occidentale : les Anglais parlaient du Yule log, les Italiens du ceppo, les Allemands de la Christklotz, tous symboles du feu protecteur en hiver.
-
Jean-Baptiste Thiers, Traité des superstitions (1ʳᵉ éd. 1679 ; rééd. Paris, 1741), t. I, p. 262-265. – L’abbé Thiers décrit le rituel provençal de la bûche de Noël : la tréfoire (tranche de bois fruitier) était apportée dans l’âtre le 24 décembre, bénie avec du vin par le plus jeune de la maisonnée, puis allumée solennellement. Une partie de la bûche brûlait chaque jour jusqu’à l’Épiphanie, ses cendres étant ensuite conservées pour protéger la maison ou soigner les bêtes. NB : La superstition voulait aussi que “tout pain cuit le 24 décembre se conserve dix ans sans se corrompre” et qu’il ne faut pas faire de lessive entre Noël et l’An, sous peine de malheur.
-
Nadine Cretin, art. cit. (Questes, 2016), p. 151-154. – L’usage d’un arbre de Noël décoré apparaît au XVIᵉ siècle en Alsace (registre municipal de Sélestat, 1521 : achat de sapins pour la fête de Noël). Pratique issue des mystères médiévaux (arbre du Paradis décoré lors des pièces religieuses de décembre). Dès l’Antiquité tardive, on disposait rameaux verts et lampes dans les maisons : Tertullien, au IIIᵉ siècle, se plaint que certains chrétiens suivent la coutume païenne de parer leurs portes de laurier et d’allumer des lampes aux calendes de janvier (Épiphanie). On voit là l’ancêtre de nos couronnes et guirlandes de sapin.
-
Michel Sot (dir.), Pratiques de la médiation des savoirs, éd. CTHS, 2019, p. 215. – « Il est de coutume d’attribuer la tradition orale des contes populaires aux longues veillées d’hiver qui réunissaient tour à tour, dans l’une ou l’autre maison, tous les voisins d’un même quartier rural. » Voir aussi : « Les veillées d’autrefois », Ciclic.fr (mémoire Centre-Val de Loire), 2019 : les veillées paysannes, jusqu’au XIXᵉ siècle, restaient le lieu privilégié de la transmission orale.
-
Jean-Baptiste Thiers, Traité des superstitions, op. cit., p. 264-265. – Le pain de Calende (ou pain de Noël) était pétri la veille de Noël, aussi blanc et gros que possible, puis réservé jusqu’à l’Épiphanie, où on le partageait en famille. On en découpait un morceau mis de côté « pour guérir plusieurs maux ». Tradition du pain de fête répandue sous divers noms dans toute la France, souvent associée à des gestes de charité ou de présage.
-
Jacob & Wilhelm Grimm, « La Dame Holle », in Contes de l’enfance et du foyer, vol. 1 (1812), trad. Félix Frank & E. Alsleben (Paris, XIXᵉ s.). Ce conte-type (AT 480) illustre le mythe de la « Mère hiver » : la vieille Dame Holle gouverne les phénomènes hivernaux et distribue récompenses ou châtiments selon le mérite. Cf. aussi la symbolique de la couette secouée dans d’autres folklores.
-
Jacob Grimm, Notes du conte Frau Holle, édition originale 1812 (annotations des Grimm). – Les Grimm rapportent qu’en Hesse (Allemagne), « Wenn es schneit, so sagt man: Frau Holle schüttelt ihre Betten aus. » (« Quand il neige, on dit : Dame Holle secoue ses lits. ») Figure possiblement issue d’une très ancienne déesse de la fertilité et de l’hiver (Holda, Perchta), intégrée dans le folklore chrétien sous les traits d’une fileuse bienfaitrice.
Vous pourriez aimer aussi :

La Chandeleur : fête de la lumière et des crêpes
Cet article propose aux parents d’expliquer simplement la Chandeleur aux enfants et d’où vient cette fête.
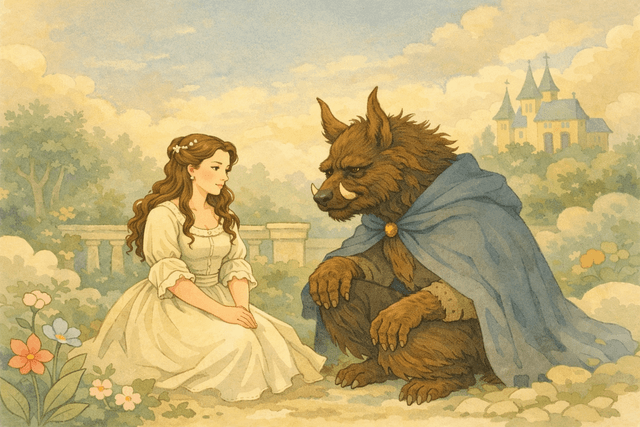
La Belle et la Bête (1756) — Version de Beaumont (Magasin des enfants)
La version longue (1740) de La Belle et la Bête par Madame de Villeneuve, orthographe modernisée, idéale en lecture acco…

La galette des rois : histoire, traditions et gourmandise
Découvre l’histoire de la galette des rois, ses origines anciennes, ses coutumes familiales et les deux grandes recettes…

Noël : histoire, traditions et lumière d’hiver
Découvre les origines du sapin, de la crèche, des chants, et la naissance de Jésus : un voyage à travers les traditions …

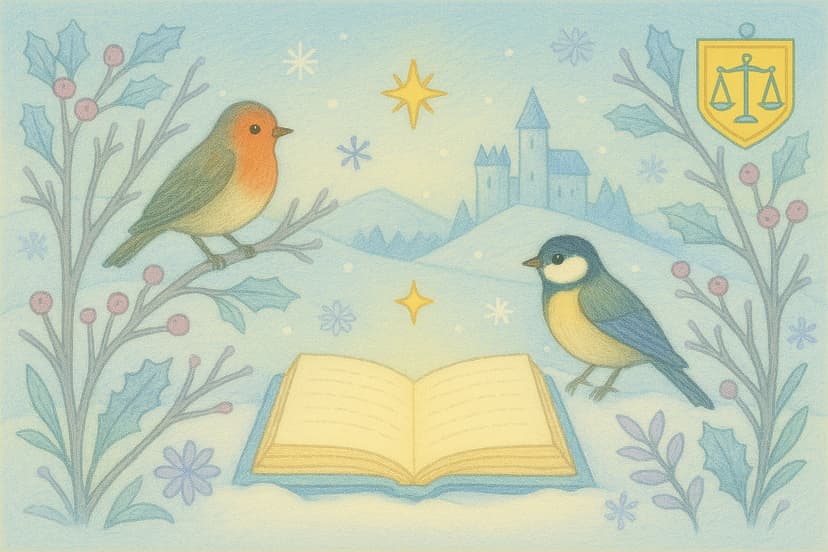
Et toi, qu’en as-tu pensé ?