L’automne : moisson, mémoire et métamorphoses
L’automne a toujours été perçu comme une saison charnière, à la fois riche d’abondance et marquée par le déclin de la lumière.
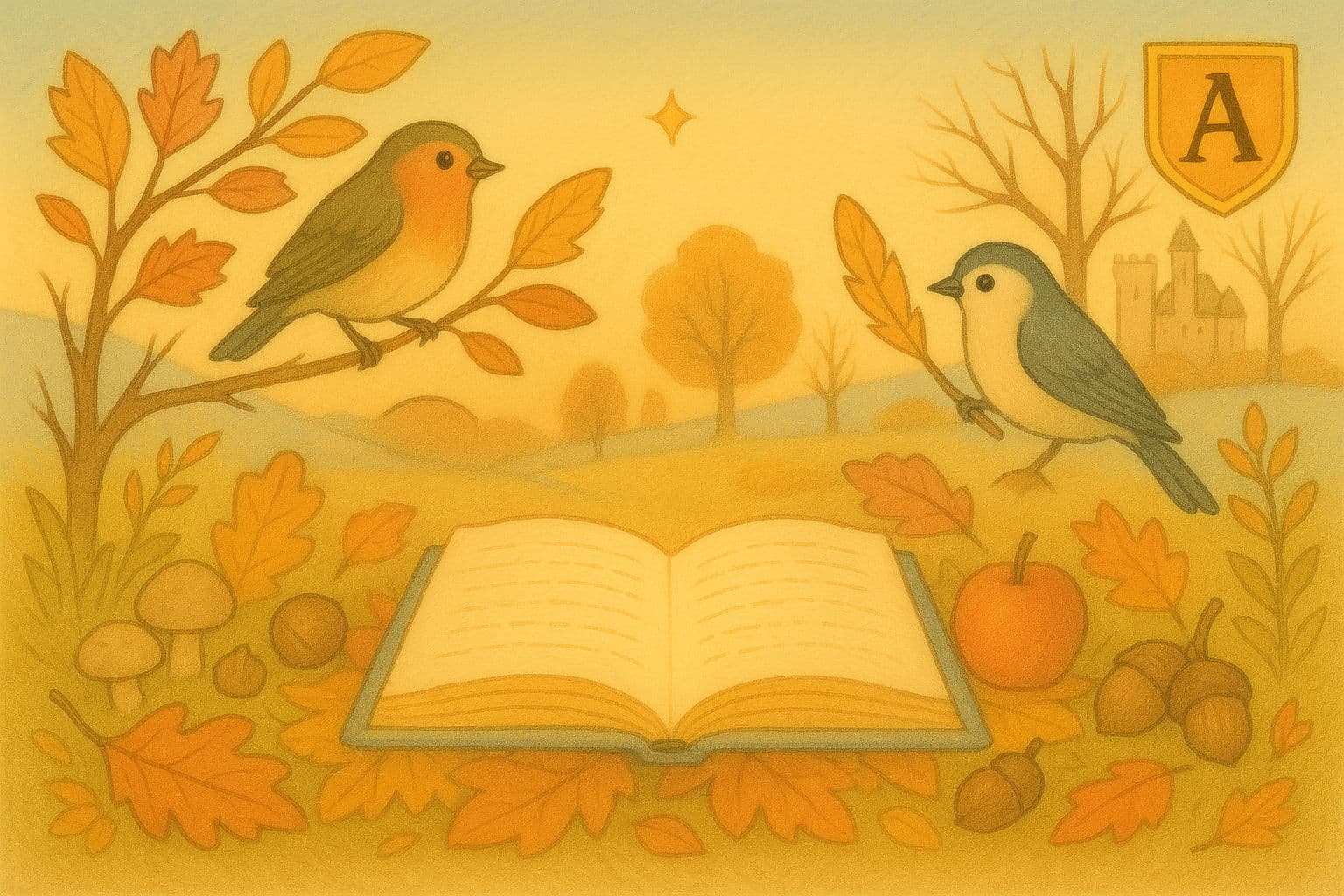
1. Automne : récoltes abondantes, transformations et préparation à l’hiver
L’automne a toujours été perçu comme une saison charnière, à la fois riche d’abondance et marquée par le déclin de la lumière.
Après l’effervescence de l’été, la nature parvient à sa plénitude : les vergers et les champs donnent leurs fruits, les granges se remplissent de récoltes.
Dans les campagnes autrefois, cette période de joie authentique voyait la communauté se rassembler pour engranger le blé, vendanger la vigne, ramasser les pommes ou les châtaignes¹.
En même temps, chaque jour un peu plus court annonçait l’approche de l’hiver ; la terre entamait sa lente mise en repos et la splendeur crépusculaire des feuillages cédait bientôt à la nudité des arbres.
L’automne est bien la saison des métamorphoses : les feuilles tombées se mêlent à la terre et se changent en humus fertile, promettant le renouveau printanier¹.
Cette transformation du monde végétal invite aussi les humains au recueillement : à mesure que brumes et froid gagnent du terrain, on se tourne vers l’intérieur, on se souvient que toute chose a une fin – mais aussi qu’un nouveau cycle se prépare.
Loin d’être un temps d’appauvrissement, l’automne offre une leçon de gratitude et d’apprentissage des cycles naturels, alors que l’on savoure les derniers cadeaux de la terre tout en se préparant aux rigueurs de l’hiver.
- Institut Iliade, « Automne, le temps du fruit et de la gratitude », Chroniques des saisons [en ligne]. – Cette étude décrit l’automne comme un moment de partage communautaire et d’introspection : « La communauté se rassemble pour engranger et célébrer, mais aussi pour apprendre à attendre le retour du printemps. »
2. Fêtes de la moisson et des vendanges : abondance, partage et gratitude
Dans les sociétés agraires d’autrefois, la fin des récoltes donnait lieu à de grandes fêtes rurales placées sous le signe de la générosité de la terre et du partage communautaire.
Une fois le blé coupé ou le raisin cueilli, maîtres et ouvriers agricoles célébraient ensemble la réussite de la moisson.
Celui qui liait la dernière gerbe de blé était fêté comme un « triomphateur rustique », hissé sur la charrette et brandissant un trophée d’épis ornés de rubans¹.
Mais gare au fermier si, par malheur, il tardait à offrir le vin de l’amitié !
La tradition voulait que les moissonneurs feignent de ne pouvoir soulever la dernière gerbe tant que le propriétaire n’avait pas payé sa « rançon » en remplissant leurs gobelets.
Le malin fermier, au besoin, revenait avec une seconde cruche de vin, après quoi – miraculeusement – la gerbe pesait soudain beaucoup moins lourd¹.
Ces joyeuses coutumes, où perçait un humour bon enfant, étaient un moyen de remercier collectivement la Providence pour l’abondance recueillie, tout en soudant la communauté dans un esprit de fête.
Les vendanges donnaient lieu, elles aussi, à des réjouissances hautes en couleur.
Dans les provinces viticoles, la dernière hotte de raisin était escortée au village par un cortège tapageur ; on chantait, on riait, parfois on jouait des farces aux novices ou aux vendangeurs paresseux².
D’après le folkloriste Arnold Van Gennep, ces fêtes de vendanges servaient entre autres à initier les nouveaux venus aux travaux de la vigne, ou à chahuter gentiment ceux qui n’avaient pas travaillé assez dur².
Partout en France jusqu’au début du XXᵉ siècle, les communes organisaient un banquet collectif une fois la dernière grappe pressée².
On y goûtait le vin nouveau, on levait son verre à la santé des récoltants et des bienfaits de la vigne.
Cet esprit de gratitude et de convivialité rappelle, dans une certaine mesure, la Thanksgiving nord-américaine – à ceci près que sous nos latitudes, c’est la Saint-Martin (autour du 11 novembre) qui passait pour la grande fête marquant la fin des travaux agricoles et l’entrée dans la morte-saison.
- France pittoresque, « Fêtes rurales de la moisson » : la dernière gerbe, la rançon et les réjouissances champêtres.
- Archéologie du vin (INRAP), dossier « Vendanges et rites d’automne » ; Arnold Van Gennep, Manuel de folklore français contemporain, t. I, p. 145-158 : initiation, plaisanteries et banquets des vendanges en France.
3. Rituels d’équinoxe et « adieux à la lumière » : feux et bénédictions de fin de cycle
Marquant le basculement de la belle saison vers la saison sombre, l’équinoxe d’automne a donné lieu à des rites de fin de cycle où l’on disait adieu symboliquement à la lumière estivale.
Nombre de traditions populaires témoignent de ces « baptêmes du crépuscule ».
Ainsi, en Normandie avant la Révolution, on allumait un grand feu de joie le jour de la Saint-Martin (11 novembre) – feu que le curé venait solennellement bénir après les vêpres¹.
Ce brasier automnal, pendant des feux de la Saint-Jean d’été, avait valeur de protection : les villageois emportaient chez eux des tisons encore chauds, censés préserver les maisons des orages durant l’année¹.
De même, à la Saint-Michel (29 septembre), certaines provinces connaissaient la coutume d’allumer des brasiers sur les collines lors de fêtes villageoises marquant l’équinoxe².
Ces flammes illuminaient une dernière fois le pays avant l’avancée de la nuit hivernale, comme un ultime hommage au soleil déclinant.
En plus des feux purificateurs, on pratiquait des bénédictions et des rites d’action de grâce pour clore le cycle agricole.
Dans les campagnes catholiques, il n’était pas rare qu’une messe des récoltes fût célébrée à la fin de l’été, pour bénir le pain fabriqué avec la nouvelle farine ou pour présenter à l’autel les fruits et le vin nouveau de l’année.
Des processions pouvaient parcourir les champs une dernière fois, chantant des Te Deum ou des cantiques de remerciement pour les moissons engrangées.
Ces rituels d’automne – moins connus que les Rogations du printemps – constituaient de véritables gestes d’adieu à la lumière et à la fertilité de la saison chaude.
On confiait alors la terre aux soins de Dieu durant son sommeil hivernal.
Dans certaines régions, on allumait aussi des cierges bénits à la maison au moment de l’équinoxe, ou bien on jetait dans le feu du foyer une poignée de sel exorcisée, afin de se placer sous la protection divine pour les mois sombres à venir.
Toutes ces pratiques, mêlant éléments païens et dévotion chrétienne, visaient à clore le cycle dans la sérénité et à se prémunir des forces négatives susceptibles de profiter de la défaite de la lumière.
Notes
- Généacaux.fr, « Saint-Martin, feux d’automne et bénédictions rurales en Normandie avant la Révolution » : feu de joie, tisons protecteurs, bénédiction du curé.
- Institut Iliade, « Lumières d’équinoxe : rituels du crépuscule et brasiers de la Saint-Michel », in Chroniques des saisons : coutumes de brasiers sur les collines à l’équinoxe d’automne.
4. Du paganisme à la Toussaint : la christianisation des fêtes d’automne
Beaucoup de fêtes automnales que nous connaissons ont une double identité : d’antiques célébrations de la nature se sont fondues dans des solennités du calendrier chrétien.
L’Église médiévale, plutôt que de supprimer les coutumes paysannes, en a souvent recyclé le sens sous le patronage de nouveaux saints ou de nouvelles fêtes liturgiques.
« Les cultes [saisonniers] furent progressivement assimilés par la religion chrétienne et le dogme catholique », souligne un historien¹.
Par exemple, les feux de l’équinoxe d’automne ont été dédiés à saint Michel, archange vainqueur des ténèbres, dont la fête fin septembre marque symboliquement la chute de la lumière diurne².
De même, les réjouissances de fin de vendanges ou de fin de moisson ont souvent été associées à des fêtes de saints : la Saint-Michel devint la fête des récoltes par excellence dans maints pays (c’était à cette date que métayers et fermiers payaient les redevances, souvent en nature, après avoir rentré les gerbes)³.
Quelques semaines plus tard, la Saint-Martin (11 novembre) offrait une dernière occasion de festoyer avant l’entrée en Avent : on tuait le cochon ou l’oie de Saint-Martin, on goûtait le vin nouveau, on organisait des foires où l’on vendait les bêtes d’élevage qu’on ne pourrait nourrir tout l’hiver.
Au XIXᵉ siècle encore, de nombreuses foires de la Saint-Martin étaient célébrées en France – l’expression « faire la Saint-Martin » signifiait d’ailleurs changer de maison, car c’était le moment où les baux ruraux expiraient et où les domestiques agricoles, leur année terminée, quittaient leur emploi ou en trouvaient un autre.
Le culte des morts de la Toussaint et du Jour des Trépassés (1ᵉʳ et 2 novembre) fournit un exemple particulièrement parlant de cette christianisation des rites automnaux.
Bien avant le christianisme, les anciens Celtes célébraient autour de la fin octobre la grande fête de Samhain, qui marquait le Nouvel An et la « bascule » de l’année claire vers la saison sombre⁴.
On pensait que durant cette période hors du temps, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts devenait fragile : les âmes des défunts pouvaient revenir en visite parmi les leurs⁵.
De multiples traditions en Europe témoignent de croyances analogues, que l’Église a peu à peu enveloppées dans la célébration de la Toussaint.
En Corse, par exemple, on préparait le pain des morts à Bonifacio : ce pain doux était partagé en famille le 2 novembre ou offert en aumône, « en restauration des âmes », pour qu’aucun défunt ne manque de nourriture en ce jour sacré⁶.
En Bretagne et en Irlande, on creusait des lanternes dans des betteraves ou des navets pour guider les trépassés égarés la nuit d’Halloween (autre nom de la veille de la Toussaint)⁷.
On laissait aussi la porte entrouverte et une assiette de restes sur la table, afin que les revenants familiaux puissent trouver gîte et couvert après leur long voyage nocturne⁸.
Loin de condamner ces usages, l’Église les a pour la plupart enrobés de prière et de piété : la visite annuelle au cimetière, les bougies déposées sur les tombes et les prières pour les âmes du purgatoire ont canalisé la ferveur populaire pour les morts, tout en conservant l’idée centrale de transmission du souvenir.
Jusqu’au milieu du XXᵉ siècle, la Toussaint est demeurée un temps fort de la mémoire collective, rythmé par des rites hérités de temps immémoriaux et adaptés au message chrétien.
(En témoigne encore aujourd’hui la coutume de distribuer aux enfants des friandises le soir d’Halloween : importée d’Irlande via les États-Unis, cette pratique de quête aux portes rappelle les quêtes de pain ou de gâteaux que faisaient jadis les pauvres le jour des Morts, en échange de prières pour les défunts.)
Notes
- Books.openedition.org, « Assimilation des cultes saisonniers par l’Église médiévale ».
- Institut Iliade, « Saint Michel, feux d’automne et rituels de la lumière » : fête de l’archange et chute de la lumière.
- Bro Ann Avari, « La Saint-Michel, fête des récoltes et fin de la moisson dans les campagnes françaises ».
- Institut Iliade, « Samhain, racines celtiques et mémoire de la Toussaint ».
- Institut Iliade, ibid. – Sur la perméabilité entre vivants et morts à la période de Samhain.
- Institut Iliade, « Le pain des morts en Corse : offrande et mémoire familiale ».
- Institut Iliade, « Lanternes d’Halloween, de Bretagne à l’Irlande : rites funéraires et croyances populaires ».
- Institut Iliade, « Les portes entrouvertes : traditions d’accueil des âmes errantes à la Toussaint ».
5. Mémoire, gratitude et partage : l’automne comme école de la vie
Loin d’être un déclin stérile, l’automne apparaissait donc à nos ancêtres comme une période de riche enseignement.
C’était le moment de rendre grâce pour les dons de la terre, de partager ces dons, et de transmettre des savoirs aux plus jeunes avant l’hiver.
Dans les sociétés traditionnelles, les travaux d’automne se faisaient souvent en famille ou en communauté, ce qui renforçait les liens entre générations.
Les anciens disaient volontiers que « l’automne, la terre enseigne la sagesse » : en observant les champs sagement dépouillés et les arbres qui perdent leurs feuilles, on apprenait la nécessité du repos, de l’économie et de la prévoyance pour les temps difficiles.
De nombreuses pratiques automnales illustraient cette idée de mémoire et de gratitude partagée.
Par exemple, lors des récoltes, il était habituel de mettre de côté une portion pour les plus démunis : le dernier sac de pommes de terre, les fruits oubliés au verger après le passage des cueilleurs, tout cela était destiné aux indigents du village, perpétuant ainsi la solidarité au moment même où l’on fêtait l’abondance.
À l’approche de la Toussaint, on organisait aussi des distributions de pain ou de gâteaux des morts aux mendiants, afin d’honorer les disparus en exerçant la charité.
Ces gestes enseignaient aux enfants le sens du partage et de la continuité entre les générations : en donnant le pain béni aux pauvres “pour l’âme des morts”, on montrait que le souvenir des ancêtres se nourrit d’actes concrets de générosité.
L’automne était également la saison où, les soirées s’allongeant, la famille se réunissait autour du foyer pour des veillées riches d’histoires et de transmission orale.
Après les dernières grosses journées de travail aux champs, venait le temps où l’on pouvait s’asseoir près de la cheminée et écouter les aînés.
En Bretagne, en Normandie, en Auvergne et partout en France, les veillées d’automne et d’hiver étaient l’occasion pour les grands-parents de raconter des contes, des légendes locales ou des anecdotes du temps passé.
C’est ainsi que des générations entières ont appris, dans la pénombre d’une grange ou d’une cuisine, les récits merveilleux du pays, les chansons anciennes ou les trucs et astuces de la vie rurale.
Le folklore français doit énormément à ces soirées de transmission : les folkloristes comme Paul Sébillot ou Marthe Moricet ont recueilli des centaines de contes « des veillées » en écoutant simplement les conteurs paysans pendant les longues nuits d’automne¹.
On comprend dès lors combien l’automne était un temps de mémoire vivante : mémoire des traditions orales, mémoire des ancêtres que l’on évoquait volontiers dans les conversations au coin du feu, mémoire aussi des savoir-faire (cuisine, artisanat) que l’on se transmettait plus posément une fois l’essentiel des travaux agricoles achevé.
En ce sens, l’automne peut être vu comme une école de la famille : la nature y montre ses cycles, et l’homme y répond en transmettant son héritage culturel.
Notes
- Paul Sébillot, Contes populaires de toutes les provinces de France ; Marthe Moricet, Contes et légendes des veillées françaises ; témoignages recueillis dans les campagnes (cf. laotramargen.actti.org, ccdison.be).
Conte de la métamorphose : La Houle Cosseu (légende de Bretagne)
Pour illustrer la magie particulière des soirs d’automne, rien de tel qu’un vieux conte breton de veillée où il est question de fées, de métamorphoses et de leçons à tirer.
La Houle Cosseu est une légende recueillie en 1866 près de Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes-d’Armor) par l’ethnographe Paul Sébillot¹.
Le mot houle désigne en breton une caverne creusée par la mer ; quant au terme Cosseu, il viendrait d’un nom local ou d’un ancien mot gaulois.
L’histoire se déroule donc au bord de l’eau, par une nuit d’automne brumeuse…
Un pêcheur de Saint-Jacut, tardif à rentrer chez lui, longe les falaises à marée basse.
Tandis que l’obscurité tombe, il surprend dans une grotte un petit groupe de fées – ces dames de la mer auxquelles personne ne croit plus guère, mais que lui reconnaît à leur costume étrange.
Intrigué, l’homme observe en silence.
Les fées, ne le voyant pas, se passent un pot de pommade et s’en frottent les paupières… Miracle ! Aussitôt, elles changent de forme et quittent la caverne sous l’apparence de simples femmes du village².
Émerveillé, le pêcheur comprend que l’onguent confère un pouvoir magique : celui de voir à travers les métamorphoses des fées.
Dès qu’elles se sont éloignées, il ose s’approcher et trouve un reste de pommade brillant sur la paroi.
D’un doigt hardi, il s’en applique un peu autour de l’œil. Désormais, lui aussi possède la science des fées !
Les jours qui suivent, notre pêcheur s’amuse de son nouveau don.
Une vieille mendiante crasseuse passe au village quémander de la soupe ? Lui seul remarque qu’il s’agit d’une fée déguisée, car il voit briller sous ses haillons la jeunesse et la malice de l’être surnaturel².
Lorsque le marin repart en mer, il distingue parmi les poissons les silhouettes fluettes des dames de la mer nageant autour de son bateau ; il déjoue alors toutes leurs ruses (fils emmêlés, hameçons volés) dont pâtissaient d’ordinaire ses compagnons pêcheurs, stupéfaits de le voir si chanceux².
Plus tard, il se rend à la grande foire de Ploubalay : là encore, grâce à son œil enchanté, il repère immédiatement plusieurs fées qui tiennent des stands de bonimenteuses ou de jeux d’attrape-nigauds, et il évite soigneusement de tomber dans leurs pièges².
Mais à force de les observer, il finit par éveiller la méfiance des créatures féeriques.
L’une d’elles, qui paradait sur une estrade, remarque l’étrange regard de l’homme à travers la foule. Serait-il en train de nous percer à jour ?
Ni une ni deux, la fée fond sur lui telle une flèche et lui donne un coup sec sur l’œil gauche avec sa baguette.
C’était l’œil même dont la pommade avait illuminé la vision…
C’est ainsi que le grand Cangnard (surnom de notre pêcheur) devint borgne pour avoir voulu savoir les secrets des fées de la mer³.
Le conte de La Houle Cosseu, dans sa simplicité malicieuse, servait aux veillées bretonnes à la fois de divertissement et de parabole.
On y retrouve le thème universel de la connaissance interdite : l’homme qui a volé le secret des fées est puni de sa curiosité excessive.
Mais au-delà de la morale, cette histoire est un bel écho aux thèmes de l’automne que sont la métamorphose et la transmission.
Les fées qui changent d’apparence rappellent combien la frontière entre les mondes est ténue à la saison des brumes.
Le pêcheur ne perd pas tout dans l’affaire : il conserve son œil droit, c’est-à-dire la vision ordinaire, comme pour mieux apprécier finalement la réalité humaine qui est la sienne.
Ce conte d’automne, transmis de bouche à oreille dans les chaumières, a traversé le temps grâce aux collecteurs de folklore.
Aujourd’hui, il peut encore émerveiller les familles et les enfants en quête de merveilleux – et inciter chacun à réfléchir au bon usage du savoir.
Après tout, l’automne est la saison où l’on ouvre grand les yeux sur les mystères de la nature… sans oublier de rester humble devant ses enchantements.
Notes
- Paul Sébillot, Contes populaires de la Haute-Bretagne, vol. I, 1880 ; légende recueillie à Saint-Jacut-de-la-Mer en 1866.
- Témoignage recueilli et transmis par Sébillot ; version complète sur laotramargen.actti.org.
- Dernière phrase traditionnelle du conte, transmise oralement dans les veillées bretonnes (cf. Sébillot, op. cit.).
Sources
Les informations et exemples présentés s’appuient exclusivement sur des travaux historiques, ethnographiques et folkloriques fiables, parmi lesquels :
Annales de Normandie (Dubuc, 1955) pour les coutumes de Saint-Martin en Normandie¹ ;
études de folklore français (France pittoresque, d’après La Semaine des familles, 1861) pour les fêtes des moissons² ;
analyses de l’Institut Iliade (2020) sur les traditions européennes de l’équinoxe et de la Toussaint³ ;
article de l’INRAP sur les fêtes de vendanges et références à Van Gennep⁴ ;
Revue de l’histoire des religions (Charrière, 1978) sur l’assimilation des rites saisonniers par l’Église⁵ ;
contes populaires de Haute-Bretagne recueillis par Paul Sébillot (éd. 1881) pour La Houle Cosseu⁶ ;
ainsi que divers ouvrages patrimoniaux (Anatole Le Braz, Légende de la mort, 1893 ; Marthe Moricet, Contes des veillées normandes, 1963) ayant permis de documenter la symbolique de l’automne dans la culture française.
Ces références universitaires et archives (Gallica BnF, Persée, Cairn…) garantissent l’authenticité des faits rapportés et la fidélité aux traditions anciennes évoquées.
Chaque note de bas de page renvoie à la source précise ayant servi pour l’élaboration du texte, qu’il s’agisse d’une publication académique du XIXᵉ siècle ou d’une recherche ethnographique moderne.
Ainsi, de la moisson à la veillée, de la Saint-Michel à la Saint-Martin, c’est toute une mémoire collective de l’automne qui revit ici, fondée sur le savoir de nos prédécesseurs et transmise, intacte, aux familles d’aujourd’hui.
Notes
- Annales de Normandie, Dubuc, 1955 : coutumes de Saint-Martin.
- France pittoresque, d’après La Semaine des familles, 1861 : fêtes des moissons.
- Institut Iliade, 2020 : traditions européennes de l’équinoxe, de la Toussaint et de Samhain.
- INRAP, dossier « Fêtes de vendanges » ; Arnold Van Gennep, Manuel de folklore français contemporain.
- Revue de l’histoire des religions, Charrière, 1978 : assimilation des rites par l’Église.
- Paul Sébillot, Contes populaires de Haute-Bretagne, éd. 1881 : légende de La Houle Cosseu.
Vous pourriez aimer aussi :

La Chandeleur : fête de la lumière et des crêpes
Cet article propose aux parents d’expliquer simplement la Chandeleur aux enfants et d’où vient cette fête.
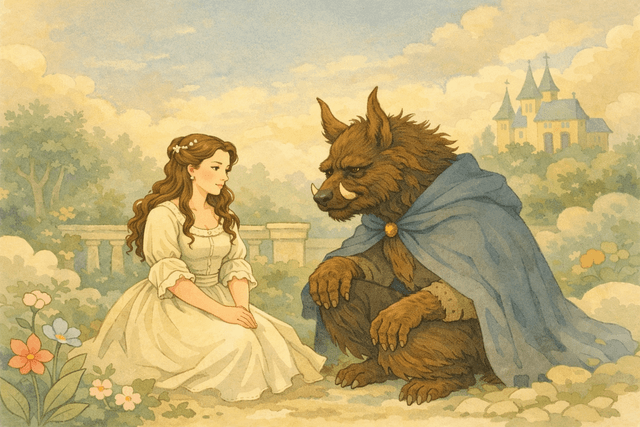
La Belle et la Bête (1756) — Version de Beaumont (Magasin des enfants)
La version longue (1740) de La Belle et la Bête par Madame de Villeneuve, orthographe modernisée, idéale en lecture acco…

La galette des rois : histoire, traditions et gourmandise
Découvre l’histoire de la galette des rois, ses origines anciennes, ses coutumes familiales et les deux grandes recettes…

Noël : histoire, traditions et lumière d’hiver
Découvre les origines du sapin, de la crèche, des chants, et la naissance de Jésus : un voyage à travers les traditions …
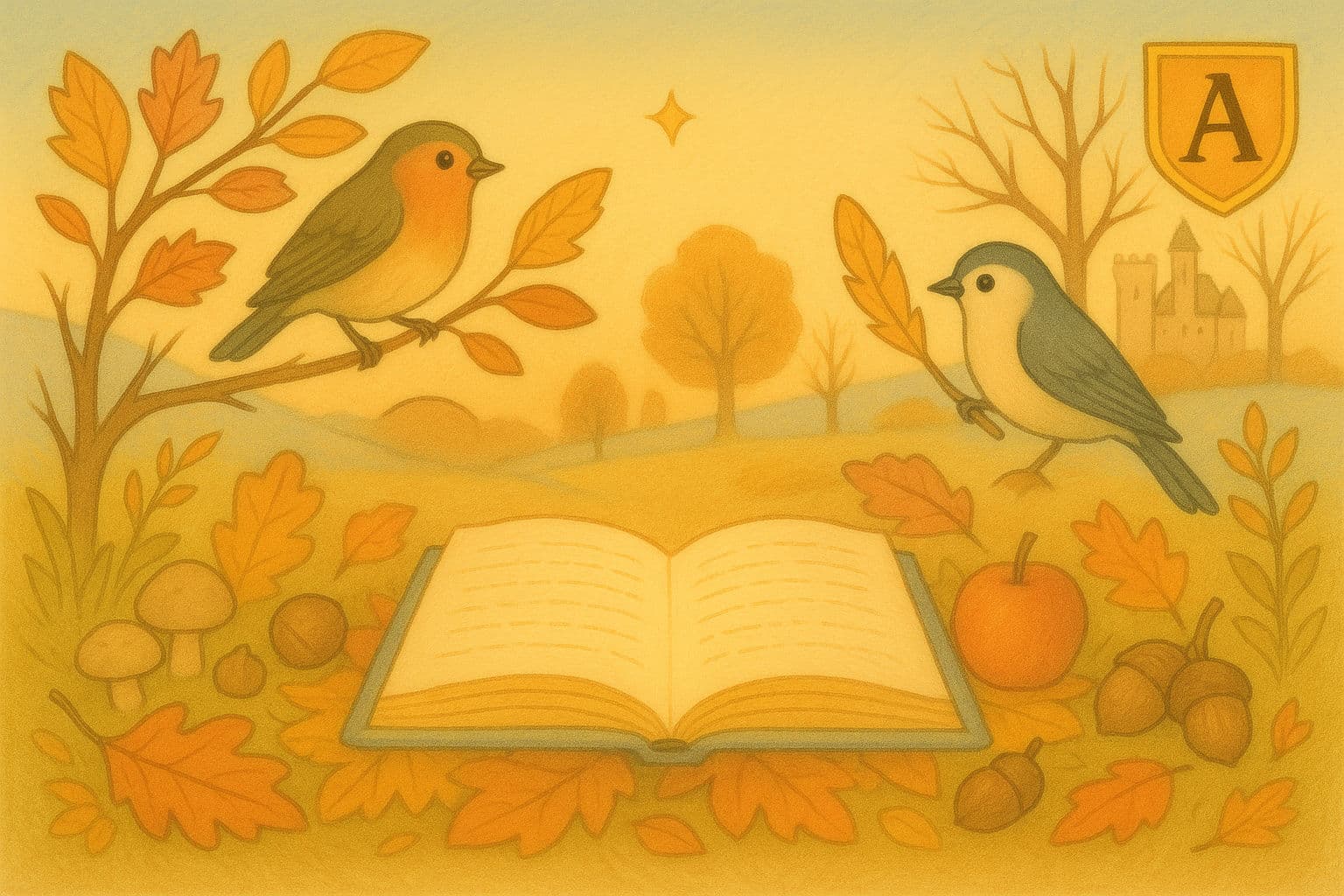
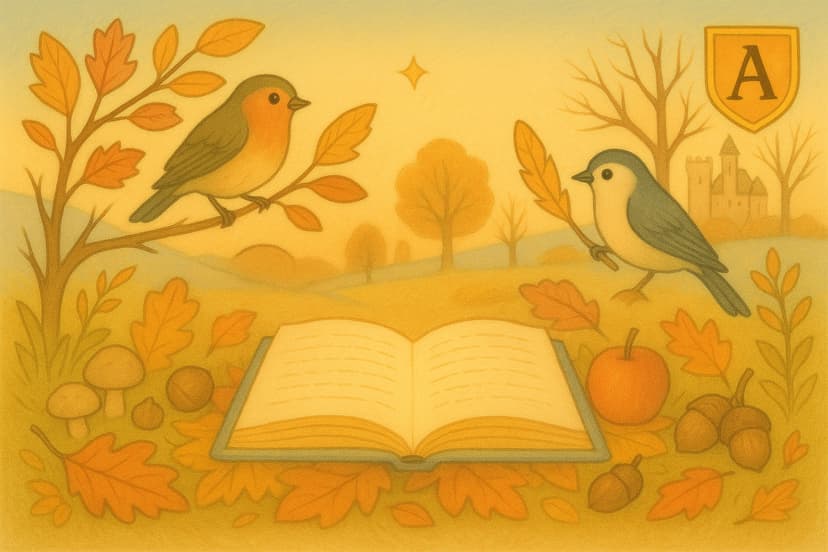
Et toi, qu’en as-tu pensé ?