Le coq : histoire d’un symbole français
Du haut des toits et des monuments jusqu’au maillot des sportifs, le coq est partout en France.
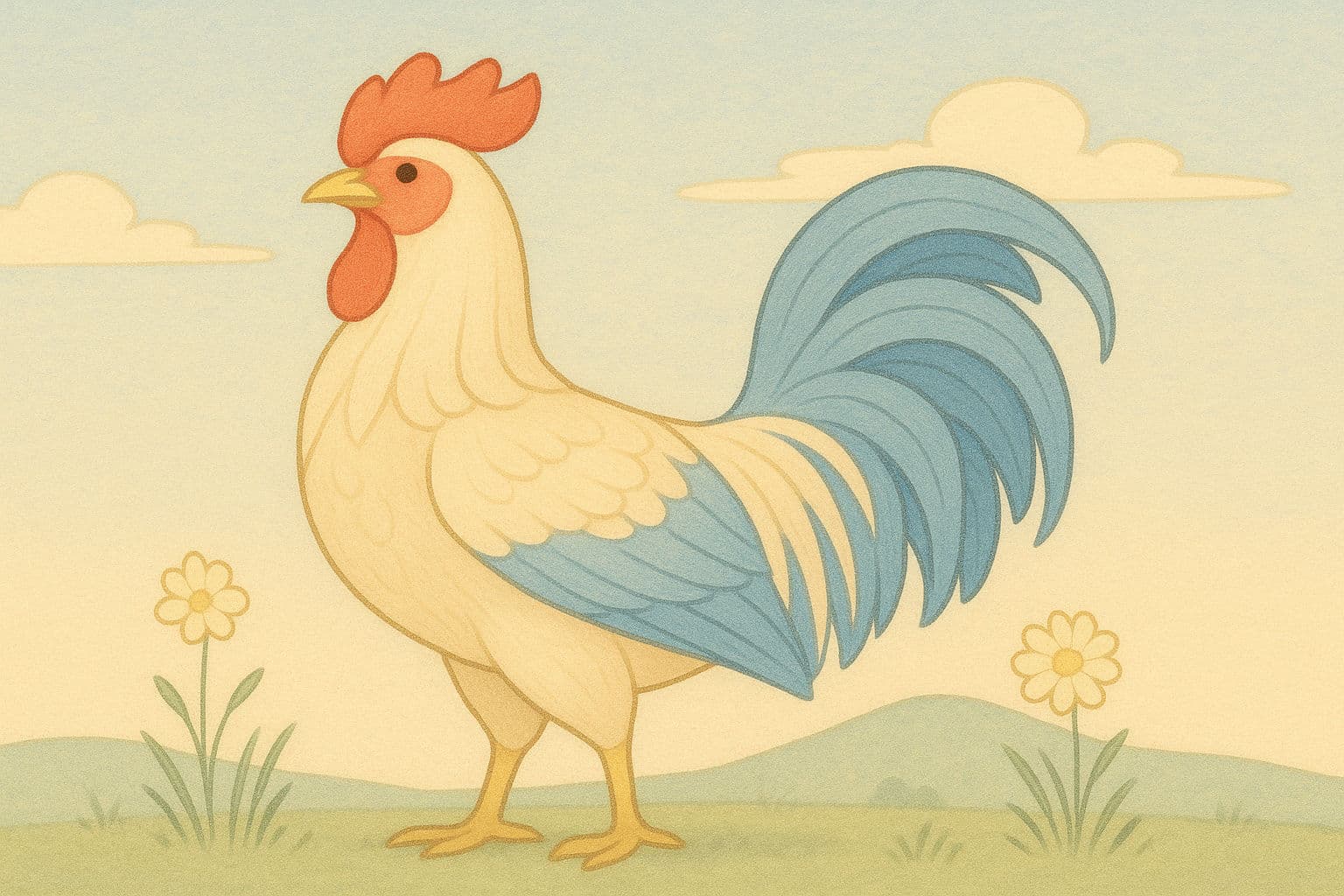
1. Le coq : histoire d’un symbole français
Du haut des toits et des monuments jusqu’au maillot des sportifs, le coq est partout en France.
Ce volatile à la crête rouge orne de nombreuses mairies et monuments aux morts, figurant le courage et l’âme du pays.
Sur les clochers des églises, il sert de girouette depuis le Moyen Âge, tournant au vent en surveillant l’horizon.
Sur les grilles du palais de l’Élysée – la résidence présidentielle – un coq en bronze monte encore la garde, héritage visible de la Troisième République.
Et bien sûr, chaque grande victoire sportive des « Bleus » (football, rugby…) est célébrée par un coq gaulois fièrement exhibé sur les maillots et drapeaux.
Symbole non officiel de la nation (la République lui préfère Marianne ou le drapeau tricolore), il n’en reste pas moins cher au cœur des Français.
À travers le coq, c’est l’image d’un peuple combatif et matinal qui continue de se transmettre, de la statue en haut du clocher jusqu’à la mascotte sur le terrain de sport.
2. Des origines antiques : un jeu de mots devenu emblème
Pourquoi le coq en particulier représente-t-il la France ? L’histoire commence par un jeu de mots latin. Dans la langue de Jules César, gallus désigne à la fois le coq et… le Gaulois. Les Romains ne manquèrent pas de railler ainsi nos ancêtres. Jules César lui-même note l’importance de cet oiseau chez les peuples de Gaule. L’association moqueuse entre Gaulois et coqs était née.
Toutefois, il s’agit bien d’un calembour : « Le coq, gallus, symbole de la Gaule, est un calembour romain, et pas autre chose », rappelait l’historien Camille Jullian en 1900.
En réalité, les Gaulois historiques ne vénéraient pas spécialement cet animal, qui n’était même pas originaire de nos contrées européennes : le coq domestique vient d’Asie du Sud-Est et a été introduit en Gaule quelques siècles avant notre ère. Aucune pièce de monnaie gauloise authentique ne portait de coq, même si l’on retrouve parfois cet oiseau sur des monnaies gallo-romaines tardives ou des artefacts romains.
En revanche, l’Antiquité gréco-romaine accordait au coq un grand rôle symbolique. Oiseau solaire par excellence (il chante à l’aube), le coq — notamment le coq blanc — était dédié à des dieux comme Jupiter ou Mercure.
Pour des philosophes de l’Antiquité tardive, il représentait la lumière, la beauté et même l’immortalité de l’âme, si bien que certaines traditions interdisaient de le manger.
Les premiers chrétiens héritèrent aussi de cette image de l’oiseau vigilant. Dans les Évangiles, c’est le chant du coq qui fait prendre conscience à saint Pierre qu’il a renié le Christ au petit matin.
Très tôt, le coq devint donc un symbole de vigilance et d’espoir au point du jour dans la foi chrétienne. D’après la tradition, le pape Léon IV ordonna vers l’an 850 que chaque église arbore un coq au sommet de son clocher, pour rappeler le passage des ténèbres à la lumière du jour (symbole de la Résurrection du Christ).
C’est ainsi qu’est née la coutume des coqs-girouettes sur les toits des églises, pratique attestée dès le IXᵉ siècle (le plus ancien coq de clocher connu, en cuivre doré, date de cette époque à Brescia, en Italie).
Le coq de clocher tourne face au vent, posture que les chrétiens ont interprétée comme l’attitude de celui qui fait front aux épreuves — image d’endurance et de foi.
3. Deux images du coq au Moyen Âge
Au Moyen Âge, l’association entre le coq et la France a survécu, tout en évoluant. Le coq gaulois avait alors un double visage.
D’un côté, les ennemis du royaume de France s’en servirent volontiers pour le ridiculiser. Ils voyaient dans le coq l’animal querelleur de la basse-cour, prompt à chanter arrogant les deux pieds dans le fumier.
Dans les chroniques étrangères ou l’iconographie satirique, le roi de France pouvait être figuré sous les traits d’un coq batailleur mais présomptueux.
De l’autre côté, les partisans de la monarchie capétienne ont peu à peu retourné le symbole à leur avantage.
L’image du coq fier et courageux commence à apparaître dans la symbolique royale. Certes, ce n’est pas un symbole officiel héraldique (les rois médiévaux lui préfèrent la fleur de lys). Mais à partir de la Renaissance, on trouve parfois un coq auprès du roi de France sur des gravures, des médailles ou des monnaies commémoratives.
Le coq devient alors un signe de vigilance patriotique et de générosité.
Ainsi, le Roi-Soleil Louis XIV ne dédaigna pas le gallinacé : son peintre Charles Le Brun intégra des coqs dans le décor du palais de Versailles, alternant avec les fleurs de lys royales.
Preuve que, moqué ou admiré, le coq accompagne l’histoire de France sans discontinuer ou presque depuis l’époque gallo-romaine.
4. Contes, légendes et dictons autour du coq
Le coq a aussi conquis une place à part dans la culture populaire française.
« Fier comme un coq », dit-on d’une personne à l’orgueil un peu naïf – image empruntée à la démarche bombastique du coq qui fait la roue dans la cour de ferme.
De nombreux contes et fables mettent en scène l’animal et son fameux chant du matin. Dans les campagnes, on racontait que le chant du coq à l’aube chasse les esprits de la nuit et annonce un jour nouveau sans maléfices.
Le folklore chrétien y voyait le symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ainsi une ancienne hymne latine compare le coq au Christ :
« L’oiseau qui annonce le jour chante la lumière prochaine ; déjà le Christ, éveillant nos âmes, nous appelle à la vie. »
Dans la littérature française, l’exemple le plus célèbre est sans doute Le Coq et le Renard de Jean de La Fontaine. Le poète y met en scène un vieux coq perché sur son arbre, que le rusé renard essaie d’attirer en bas en lui annonçant la paix universelle entre animaux. Mais le coq n’est pas dupe et prétend apercevoir deux chiens courant apporter la nouvelle : le renard effrayé prend la fuite.
La morale tombe, malicieuse :
« C’est un double plaisir de tromper un trompeur. »
Depuis les fabliaux du Moyen Âge jusqu’aux fables de La Fontaine au XVIIᵉ siècle, le coq incarne la ruse vigilante qui déjoue les pièges, mais aussi l’orgueil de celui qui chante trop fort sa victoire.
Dans Chantecler (1910), une pièce plus tardive d’Edmond Rostand, le coq du village est même persuadé que son chant fait se lever le soleil !
Ces histoires montrent que cet oiseau familier est depuis longtemps un personnage à part entière de l’imaginaire français.
5. De la Révolution à la République : le réveil du coq gaulois
À la fin du XVIIIᵉ siècle, le coq gaulois achève sa transformation en emblème national positif.
La Révolution cherche alors des symboles pour remplacer ceux de l’ancienne monarchie : exit la fleur de lys, les révolutionnaires hésitent entre la figure de la Liberté, le bonnet phrygien, et le coq gaulois pour représenter le peuple.
En 1791, l’Assemblée adopte officiellement le coq comme symbole de vigilance sur les pièces de monnaie : on propose de graver un coq au revers des futurs écus révolutionnaires, « symbole de la vigilance veillant aux côtés de la Liberté ».
Sous la Première République, le sceau de l’État représente la Liberté sous les traits d’une déesse assise, tenant une lance surmontée d’un bonnet phrygien, avec un coq à ses pieds.
Le coq orne également des objets du quotidien : assiettes, drapeaux, gravures populaires.
Napoléon et le coq : une brève disgrâce
Lorsque Napoléon Bonaparte prend le pouvoir, il écarte le coq au profit de l’aigle impérial. « Le coq n’a point de force, il ne peut être l’image d’un empire tel que la France, » aurait-il objecté en refusant ce symbole jugé trop champêtre.
Le Premier Empire relègue donc notre volatile au poulailler.
Après la chute de Napoléon, le coq reprend sa place sentimentale.
En 1830, la Monarchie de Juillet remet le coq à l’honneur : une ordonnance royale prescrit que le coq figure désormais sur les boutons d’uniforme et au sommet des drapeaux de la Garde nationale.
Le coq républicain, de 1848 à nos jours
La Deuxième République (1848) adopte le coq sur son sceau d’État.
Sous la Troisième République, il devient l’animal-emblème le plus populaire : on le voit sur les timbres-poste, les frontons des mairies, et sur la pièce d’or de 20 francs dite « au coq » (1899), où il apparaît rayonnant au-dessus de la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Durant la Grande Guerre, le coq devient le symbole de la résistance.
Après 1918, de nombreuses communes placent un coq au sommet des monuments aux morts.
Au XXᵉ siècle, même sans statut officiel, le coq reste omniprésent : timbres, objets du quotidien, mascottes sportives, emblème familier de la France dans le monde entier.
Références
Luc Binet & Catherine Glazas, « Le coq, figure héraldique et symbolique », Revue historique des Armées, n°228, 2002.
Camille Jullian, « Le prétendu coq gaulois », dans Henri Ducrocq, Le Coq gaulois, Paris, 1900.
Archives Parlementaires, Projet de décret sur l’empreinte des monnaies (9 avril 1791).
Colette Beaune, « Pour une préhistoire du coq gaulois », Médiévales, n°10, 1986.
Michaël Seigle, « Le coq gaulois et le coq des Gaulois : mythes et réalité », Anthropozoologica, 51/2, 2016.
Jean de La Fontaine, Fables, Livre II (1678), « Le Coq et le Renard ».
Anatole Le Braz, La Légende de la mort, 1893.
Marthe Moricet, Contes des veillées normandes, 1963.
Hymne du matin Aeterne rerum conditor, attribuée à saint Ambroise.
Monnaie de Paris : pièce de 20 francs « au coq » (1899).
Unité pastorale Sainte-Trinité (Fribourg), « Le coq de nos clochers ».
CNews, « Pourquoi un coq se trouve-t-il sur les clochers ? », 2020.
Vous pourriez aimer aussi :

La Chandeleur : fête de la lumière et des crêpes
Cet article propose aux parents d’expliquer simplement la Chandeleur aux enfants et d’où vient cette fête.
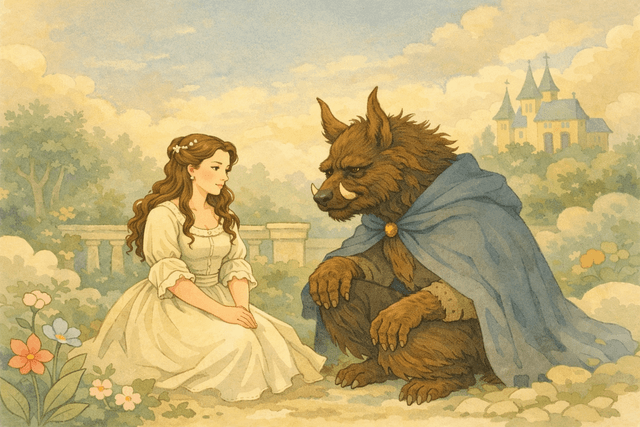
La Belle et la Bête (1756) — Version de Beaumont (Magasin des enfants)
La version longue (1740) de La Belle et la Bête par Madame de Villeneuve, orthographe modernisée, idéale en lecture acco…

La galette des rois : histoire, traditions et gourmandise
Découvre l’histoire de la galette des rois, ses origines anciennes, ses coutumes familiales et les deux grandes recettes…

L’Avent : un chemin de lumière vers Noël
Un voyage à travers l’histoire de l’Avent : ses origines anciennes, sa signification, la couronne, le calendrier et les …
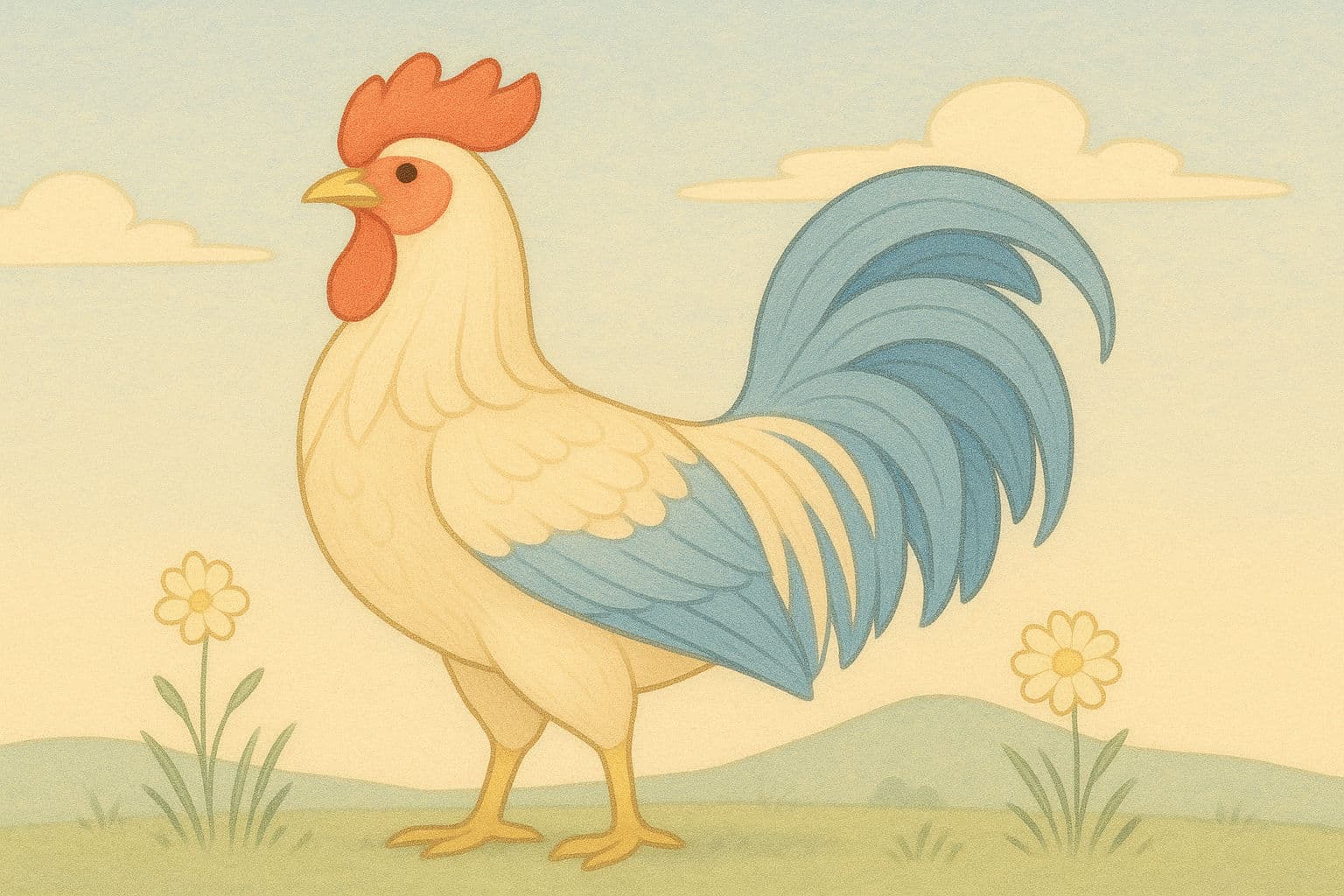
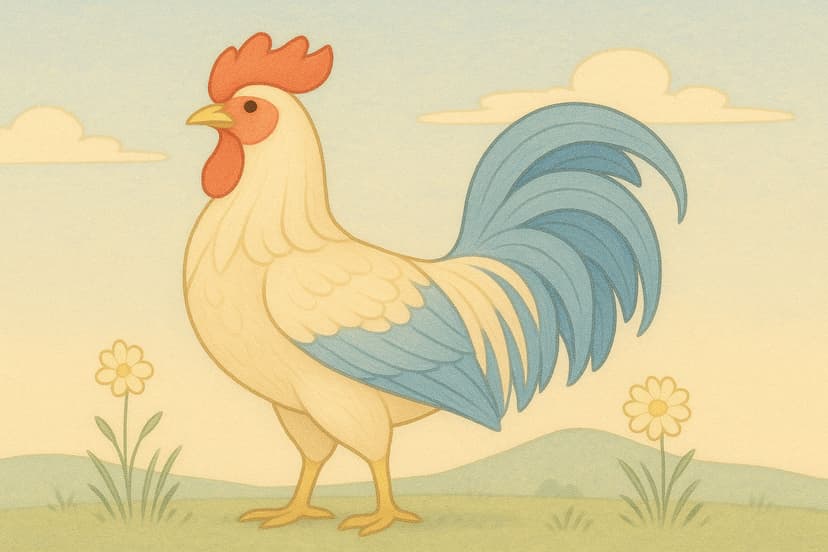
Et toi, qu’en as-tu pensé ?